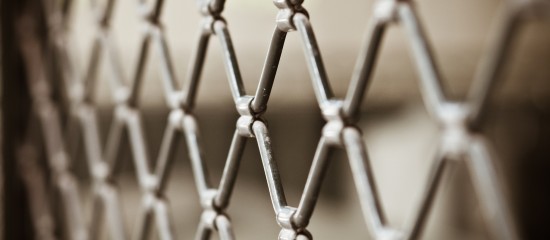Les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics en instaurant la taxe sur les transactions financières n’ont pas été remplis.
Instaurée par la loi de finances rectificative pour 2012, la taxe sur les transactions financières (TTF) s’applique à toute acquisition de titres de capital ou assimilé (actions, obligations, certificats d’investissement, par exemple), dès lors que ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger. La mise en place de cette taxe poursuivait trois objectifs : faire contribuer le secteur financier au redressement des finances publiques, exercer une action de régulation sur les marchés financiers et initier un mouvement d’adhésion des autres États membres de l’Union européenne.
À noter : le taux de la taxe sur les transactions financières est fixé à 0,2 % (0,3 % à compter du 1
Rendue publique récemment, une enquête de la Cour des comptes estime que ces objectifs n’ont pas été remplis. En effet, elle souligne que cette taxation des acquisitions de titres financiers ne pèse pas sur le secteur financier. En réalité, la TTF est collectée et reversée à l’État par le redevable, à savoir le prestataire de service d’investissement (courtier, banque…). Or, ce dernier répercute le coût de la taxe sur ses cats lors de la facturation de frais de transaction. Ce qui explique que l’instauration de la TTF ait été relativement bien acceptée par les professionnels de la finance.
Concernant le deuxième objectif, la Cour des comptes relève que la taxe sur les transactions financières n’a pas permis de faire disparaître certaines opérations nocives et de limiter les opérations de trading haute fréquence. Principale raison de cet échec, le champ d’application de la taxe est cantonné aux seules opérations réalisées par des entreprises exploitées en France. La parade était toute trouvée : ces transactions se réalisent désormais à l’étranger.
Enfin, la Cour des comptes explique que les nombreux désaccords entre les États membres n’ont pas rendu possible l’émergence d’une taxe sur les transactions financières à l’échelle européenne. La France reste donc isolée sur ce terrain.
Cour des comptes – La taxe sur les transactions financières et sa gestion
© Les Echos Publishing 2017