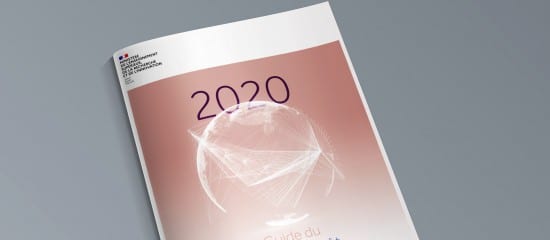La loi de finances pour 2021 permet de différer l’imposition des plus-values latentes issues d’une réévaluation libre des actifs de l’entreprise.
Afin d’améliorer la capacité de financement des entreprises dans ce contexte de crise économique, les conséquences fiscales des réévaluations libres des actifs peuvent être temporairement neutralisées.
La réévaluation libre
Les entreprises peuvent remplacer à leur bilan la valeur historique des actifs par leur valeur réelle afin de donner une image plus fidèle de leur patrimoine. L’objectif étant de renforcer leurs fonds propres afin de pouvoir accéder plus facilement au financement.
À noter : cette réévaluation doit porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières de l’entreprise.
Une neutralité fiscale temporaire
Normalement, l’éventuelle plus-value issue de cette réévaluation constitue un produit imposable de l’exercice au titre duquel intervient l’opération. La loi de finances permet de différer l’imposition de cet écart de réévaluation.
La plus-value dégagée sur les actifs amortissables est étalée sur une période de 15 ans pour les constructions et de 5 ans pour les autres immobilisations. Une réintégration qui s’effectue par fractions égales.
Précision : les amortissements, les provisions et les plus-values de cession ultérieurs des actifs doivent être calculés d’après leur valeur réévaluée.
La plus-value relative aux éléments non amortissables (marques, terrains, titres de participation…) est, quant à elle, placée en sursis d’imposition. Elle ne sera imposée que lors de la cession ultérieure des actifs concernés.
Précision : la plus ou moins-value réalisée lors de la cession ultérieure des actifs doit être calculée d’après leur valeur non réévaluée.
Attention, ce régime s’applique à la première opération de réévaluation libre des actifs constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
Une option
Il s’agit d’un dispositif optionnel. Les entreprises peuvent ne pas le choisir si elles ont intérêt à imposer immédiatement la plus-value de réévaluation (en cas d’existence d’un déficit imputable, notamment).
À savoir : un état contenant les éléments utiles au calcul des amortissements, des provisions et des plus ou moins-values relatifs aux immobilisations réévaluées doit être joint à la déclaration de résultats.
Art. 31, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30
© Les Echos Publishing 2021