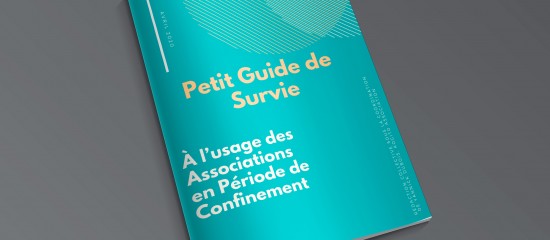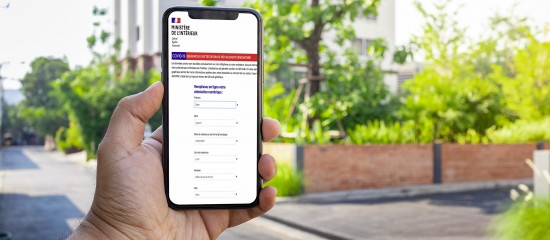Le confinement imposé pendant l’épidémie de Covid-19 perturbe inévitablement le fonctionnement des sociétés. Aussi, les règles relatives aux réunions de leurs assemblées générales ainsi que de leurs organes d’administration, de surveillance et de direction sont-elles assouplies pendant cette période.
Sont, en particulier, concernées les assemblées qui doivent statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre dernier.
Attention : ces assouplissements sont applicables aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction qui ont été ou seront tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020 (sauf prorogation de ce délai par décret et au plus tard le 30 novembre2020).
Le recours à la visioconférence
À titre exceptionnel, pendant la période indiquée ci-dessus, les assemblées générales et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction peuvent avoir lieu en visioconférence ou par d’autres moyens de télécommunication alors même que ce n’est pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdit. Il appartient à l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (le gérant de SARL, le président de SAS…) de le décider.
Condition : les moyens techniques mis en œuvre doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Précision : les associés qui participent à l’assemblée par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. De même, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Cette mesure d’assouplissement s’applique à toutes les assemblées et à tous les organes d’administration, de surveillance ou de direction, quel que soit l’objet de la décision sur laquelle ils sont appelés à statuer. Elle peut donc être mise en œuvre pour la tenue de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes.
Le recours à la consultation écrite
De même, le recours à la consultation écrite des associés est facilité. Ainsi, lorsque la loi permet que les décisions des assemblées puissent être prises par voie de consultation écrite, cette faculté peut être utilisée même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdit.
Il en est de même pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction.
Là encore, le recours à la consultation écrite peut avoir lieu pour toutes les décisions des assemblées ou des organes d’administration, de surveillance ou de direction, quel que soit l’objet de la décision considérée.
Précision : lorsque les formalités de convocation d’une assemblée avaient été accomplies avant que le recours à la visioconférence ou à la consultation écrite n’ait été décidé en raison du confinement, les associés doivent en être informés par tous moyens permettant d’assurer leur information effective 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée. Dans ce cas, il convient de procéder aux formalités qui restent à accomplir à la date de cette décision. En revanche, les formalités de convocation déjà accomplies n’ont pas à être renouvelées.
Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, JO du 26