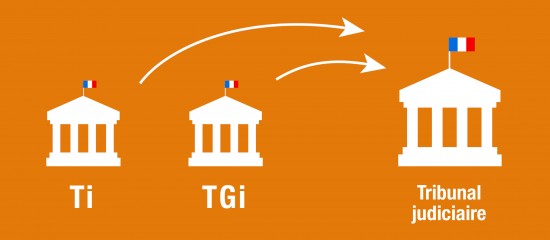L’Association Recherches & Solidarités vient de publier son 24e baromètre annuel sur la générosité des Français. Une étude basée sur l’analyse des dons aux associations mentionnés par les Français dans la déclaration de leurs revenus 2018.
Des dons en recul
Depuis 4 ans, les foyers fiscaux consentant des dons aux associations sont de moins en moins nombreux. Après une chute du nombre des donateurs de 4,2 % en 2016 et de 1,1 % en 2017, l’année 2018 a connu un recul de 3,9 %. Ainsi, 5,016 millions de foyers ont déclaré un don en 2018 contre 5,219 l’année précédente. Une diminution qui, selon les auteurs de l’étude, s’explique par les incertitudes liées à l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 et par le mouvement des « Gilets jaunes » pendant l’automne 2018.
Ces évènements ont également engendré une baisse du montant des dons récoltés par les associations. Ainsi, l’année dernière, 2,545 Md€ ont été donnés par les Français contre 2,591 Md€ en 2017, soit un repli de 1,8 %.
Une bonne nouvelle néanmoins ! Grâce, selon l’étude, à la mobilisation de donateurs fidèles, le don moyen par foyer fiscal a connu une hausse de 10 € dans la dernière année. S’élevant à 497 € en 2017, il s’établissait, ainsi, à 507 € en 2018.
Qui sont les plus généreux ?
Comme l’année précédente, les personnes âgées de plus de 70 ans sont restées les plus généreuses en 2018 : elles représentaient 34 % des donateurs et 38 % du montant des dons avec un don moyen de 587 € par foyer. Mais surtout, leur effort de don, calculé en rapprochant leur revenu moyen et leur don moyen, était le plus élevé : 2,4 % contre 1,9 % pour l’ensemble des donateurs.
Malgré un revenu moyen moins élevé, les jeunes de moins de 30 ans ont fourni un effort de don quasi équivalent, de 2,3 %, pour un don moyen de 337 €.
De l’ISF à l’IFI
Au 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a cédé sa place à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). La réduction d’impôt dont bénéficiaient les contribuables redevables de l’ISF pour leurs dons effectués auprès de certains organismes d’intérêt général a certes perduré, mais le nombre d’assujettis à l’impôt a diminué de plus de la moitié (358 000 en 2017 et 133 000 en 2018). Mécaniquement, les donateurs étaient donc beaucoup moins nombreux l’année dernière et le montant total des dons moins important.
Ainsi, alors qu’en 2017, 52 000 foyers avaient donné 269 M€, ils n’étaient plus que 20 000 en 2018 pour une collecte de 112 M€. Soit un recul des dons de 157 M€.
L’étude montre toutefois deux points positifs. D’une part, le don moyen par foyer a progressé de plus de 400 € l’année dernière (5 210 € en 2017 et 5 630 € en 2018). Et d’autre part, la densité des donateurs (rapport entre le nombre d’assujettis à l’impôt et le nombre de donateurs) est passée de 14,5 % en 2017 à 15 % en 2018.
À savoir : en 2018, les particuliers ont principalement consenti des dons à l’Association française contre les myopathies, aux Restos du cœur, à la Croix-Rouge, à Médecins sans Frontières, au Secours Catholique, à l’Unicef, à la Ligue nationale contre le cancer, à Médecins du monde, à Action contre la Faim et à Handicap international.
Recherches & Solidarités, « La générosité des français », 24e édition, novembre 2019