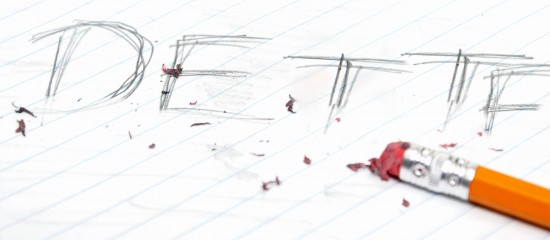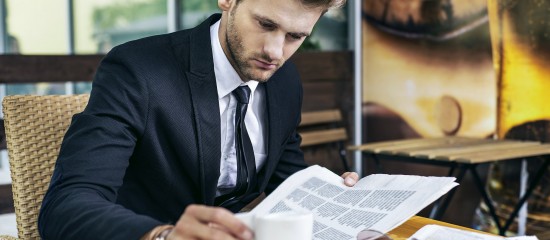Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2018. Une année marquée par une activité forte et des prix stables.
Un nombre record de transactions
L’activité sur les marchés fonciers ruraux a été particulièrement dynamique en 2018.
Ainsi, 90 800 transactions (terres agricoles et prés confondus) ont été enregistrées l’an dernier (+ 5,3 % par rapport à 2017), représentant une valeur de 4,9 Md€ (+ 5,4 %), ce qui constitue un record. Au total, 404 400 hectares (+ 6,1 %) ont changé de main en 2018.
S’agissant des vignes, le nombre de transactions a, à l’inverse, diminué de 7,5 % l’an dernier (8 750 transactions), 16 800 hectares ayant été cédés (- 0,4 %) pour une valeur totale de 844 M€ (- 31,1 %). Des chiffres qu’il faut toutefois relativiser car l’année 2017 avait été exceptionnelle, avec une dizaine de transactions record, chacune valorisée à plus de 10 M€ !
À noter : selon la FNSafer, pas moins de 55 000 hectares de terres agricoles changent d’usage chaque année en moyenne pour être affectées à l’habitat, aux zones commerciales ou aux infrastructures de transport. Et en 40 ans, ce sont 4 à 5 millions d’hectares de terres agricoles qui auraient ainsi été perdus…
Des prix stables, surtout pour les terres libres
Malgré ce dynamisme, le prix des terres et prés libres est resté stable en 2018, pour s’établir à 5 990 € l’hectare en moyenne (+ 0,1 %). Sachant que de grandes disparités existent selon les secteurs d’activité, les terres destinées aux grandes cultures affichant un prix moyen de 7 540 €/ha (+ 1,8 %) tandis que les terres promises à l’élevage ont vu leur prix diminuer de 2 % pour tomber à 4 580 €/ha en moyenne.
Quant au marché des terres et prés loués, il a progressé de 1,1 % seulement, à 4 740 €/ha en moyenne (6 080 €/ha dans les zones de grandes cultures et 3 660 €/ha dans les zones d’élevage).
Sans surprise, le prix des vignes est beaucoup plus élevé : 147 300 €/ha (+ 2,4 %) en zone d’appellation d’origine protégée (AOP), 48 700 €/ha (+ 3,8 %) dans les zones produisant des eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac) et 14 200 €/ha (+ 2,3 %) pour les zones hors AOP en 2018.
Et les parts de société ?
Avec 7 240 transactions pour un total de 1,1 Md€ en 2018, le marché des parts sociales de sociétés détenant du foncier (sociétés d’exploitation agricole et sociétés de portage) se développe. Les étrangers (surtout des Européens) n’ayant réalisé que 86 acquisitions pour 327 M€.
Le prix des terres – Analyse des marchés fonciers ruraux 2018