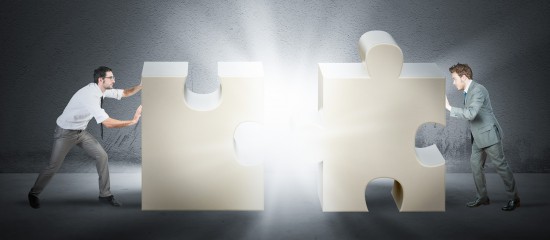Comme vous le savez, un entrepreneur individuel dispose d’un seul et même patrimoine (sauf s’il a opté pour le statut d’EIRL). Ainsi, lorsqu’il rencontre des difficultés, ses créanciers professionnels peuvent faire saisir l’ensemble de ses biens, et pas seulement ses biens professionnels. Toutefois, il lui est possible de mettre ses biens immobiliers à l’abri des poursuites de ses créanciers en les déclarant insaisissables. Explications.
Les biens immobiliers de l’entrepreneur
Les biens fonciers, bâtis ou non bâtis, que l’entrepreneur individuel n’a pas affectés à son activité professionnelle peuvent être déclarés insaisissables.
Tout entrepreneur individuel immatriculé à un registre professionnel (registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers…) ou exerçant une activité indépendante (artisan, commerçant, professionnel libéral, agriculteur) peut déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis (appartement, maison secondaire, terrain…), autres que sa résidence principale (qui est insaisissable de plein droit), dès lors qu’il ne les a pas affectés à son activité. Les micro-entrepreneurs et les entrepreneurs à responsabilité limitée (EIRL) sont également concernés.
En revanche, les dirigeants exerçant leur activité en société ne bénéficient pas de ce dispositif.
Important : depuis la loi « Macron » du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels. Mais attention, cette protection automatique ne vaut qu’à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née après le 6 août 2015. S’agissant des créanciers antérieurs, l’éventuelle déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale, souscrite en son temps, leur est toutefois évidemment opposable, tout au moins à ceux dont la créance est postérieure à cette déclaration.
Ce dispositif s’applique tant aux biens appartenant en propre à l’entrepreneur qu’aux biens qu’il détient en commun avec son conjoint ou en indivision.
À noter que si un bien est à la fois utilisé pour un usage privé et pour un usage professionnel, seule la partie utilisée à titre privé peut faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité. De même, lorsqu’un professionnel exerce son activité à son domicile, seule la partie qui n’est pas utilisée à des fins professionnelles est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels.
Une protection contre ses créanciers professionnels
Les biens de l’entrepreneur qui ont fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité ne peuvent pas être saisis par ses créanciers professionnels.
Simple et peu coûteuse, la déclaration d’insaisissabilité limite les risques patrimoniaux inhérents à l’exercice de l’activité. En effet, lorsque l’entrepreneur individuel est en difficulté, ses créanciers ne peuvent pas agir sur les biens objet de la déclaration.
Un bémol toutefois, la protection procurée par la déclaration n’est pas absolue : elle joue uniquement à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publication de celle-ci au fichier immobilier. Autrement dit, les créanciers professionnels dont la créance est née avant la déclaration d’insaisissabilité et les créanciers personnels de l’entrepreneur individuel conservent le droit de saisir les biens déclarés insaisissables. Vous avez donc intérêt à établir cette déclaration au plus tôt !
Attention : la déclaration d’insaisissabilité souscrite alors que l’entrepreneur est déjà en cessation des paiements est inopérante. Et celle qui serait effectuée dans les 6 mois précédant la cessation des paiements serait susceptible d’être annulée à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public. Il est donc vain de déclarer insaisissables ses biens quelques jours ou quelques semaines seulement avant l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire… De même, l’administration fiscale a le droit de saisir les biens immobiliers de l’entrepreneur même s’ils ont été déclarés insaisissables, lorsque ce dernier s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
L’intervention d’un notaire
La déclaration d’insaisissabilité doit être souscrite devant un notaire.
Pour souscrire une déclaration d’insaisissabilité, vous devez recourir aux services d’un notaire qui se chargera de sa rédaction. Cette déclaration sera ensuite publiée au fichier immobilier ainsi que dans le registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel vous êtes immatriculé ou dans un journal d’annonces légales si vous n’êtes pas tenu d’être immatriculé dans un tel registre.
Attention : si le mécanisme de la déclaration d’insaisissabilité est très séduisant, vous devez néanmoins l’utiliser avec parcimonie. Car à vouloir mettre trop de biens hors de portée de vos créanciers, vous réduisez d’autant votre capacité à constituer des garanties et donc à obtenir un crédit.
La cessation des effets de l’insaisissabilité
La renonciation à l’insaisissabilité de même que la vente du bien mettent fin aux effets de la déclaration d’insaisissabilité.
L’entrepreneur peut, à tout moment, renoncer à l’insaisissabilité de droit de sa résidence principale et à la déclaration d’insaisissabilité portant sur les autres biens fonciers. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens et peut être faite au bénéfice d’un ou de plusieurs créanciers déterminés. Elle devra être mentionnée sur le registre auprès duquel l’entrepreneur est immatriculé.
Par ailleurs, en cas de vente de la résidence principale, le prix de la vente demeure insaisissable à condition que l’entrepreneur réutilise cette somme dans le délai d’un an pour acquérir un immeuble où sera fixée sa résidence principale. Et en cas de vente d’un bien faisant l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, la cession de ce bien entraîne la cessation de l’insaisissabilité.
Enfin, en cas de divorce, les effets de la déclaration d’insaisissabilité subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque l’entrepreneur se voir attribuer le bien considéré. Ils subsistent également en cas de décès de l’entrepreneur mais seulement jusqu’à la liquidation de la succession.
© Les Echos Publishing 2019

En 2017, 13,1 millions de personnes (+ 3 % par rapport à 2016) étaient titulaires d’un contrat de retraite supplémentaire en cours de constitution auprès d’un établissement financier.
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) vient de publier une étude sur les retraités et les retraites. Un volet de cette étude, qui rassemble les résultats pour 2017, est consacrée à l’épargne retraite. On y apprend notamment que fin 2017, 13,1 millions de personnes (+ 3 % par rapport à 2016) étaient titulaires d’un contrat de retraite supplémentaire en cours de constitution auprès d’un établissement financier. Au cours de cette même année 2017, 13,9 milliards d’euros de cotisations ont été collectés (+ 0,8 % par rapport à 2016). Tous produits confondus (Perp, Madelin, Perco, Article 83…), 69 % des versements annuels réalisés en 2017 étaient inférieurs à 1 500 €. Un pourcentage qui atteignait 8 % pour les contrats alimentés par un versement annuel de 5 000 € ou plus.
Autre information, 73 % des adhérents à un produit de retraite supplémentaire étaient âgés de 40 ans ou plus. Et ils étaient 15 % à avoir 60 ans ou plus.
Enfin, en 2017, 2,4 millions de personnes ont perçu des prestations issues d’un contrat de retraite supplémentaire. Sachant que 2,2 millions de rentes viagères, d’un montant moyen de 2 340 €, ont été versées au titre de ces contrats.
DREES, Les retraités et les retraites, édition 2019
© Les Echos Publishing 2019

Une convention de mise à disposition d’un terrain agricole peut être considérée comme étant un bail rural lorsque l’occupant l’utilise de façon répétée et l’entretient lui-même ou à ses frais.
La convention par laquelle le propriétaire d’une parcelle autorise un éleveur à y faire paître ses animaux est soumise au statut des baux ruraux lorsqu’une telle utilisation est continue ou répétée et que l’entretien de la parcelle est mis à la charge de ce dernier.
C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un éleveur avait mis ses animaux, chaque été pendant 7 ans, en pâture sur une parcelle mise à sa disposition par sa propriétaire. Lorsque la fille de feue cette dernière avait voulu, du jour au lendemain, mettre un terme à cette convention, l’éleveur avait estimé qu’elle n’en avait pas le droit car cette convention relevait, selon lui, de la réglementation des baux ruraux.
De son côté, la propriétaire avait fait valoir que c’était sa défunte mère qui avait entretenu la parcelle et surveillé les bovins, ce qui empêchait de qualifier l’opération de bail rural.
Mais ayant constaté, au vu de factures produites par l’éleveur, que ce dernier avait procédé, à ses frais, aux opérations de fauchage, de fanage, de pressage et d’épandage sur la parcelle, et que la propriétaire s’était contentée, depuis sa maison, d’observer le cheptel, les juges ont considéré qu’il s’agissait bel et bien d’un bail rural.
Cassation civile 3e, 24 janvier 2019, n° 17-28873
© Les Echos Publishing 2019

Désormais, le dirigeant d’une entreprise en redressement judiciaire pourra, en principe, conserver sa rémunération.
Les règles applicables aux entrepreneurs qui font l’objet d’un redressement judiciaire ont été quelque peu assouplies.
Droit de proposer un administrateur judiciaire
Ainsi, d’une part, l’entreprise mise en redressement judiciaire pourra désormais proposer au tribunal le nom d’un administrateur judiciaire. Jusqu’alors, cette faculté n’était offerte qu’en cas de procédure de sauvegarde. Du coup, le chef d’entreprise pourra proposer au tribunal qu’il désigne l’administrateur qui l’a déjà accompagné pendant la procédure de sauvegarde qui a été convertie en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal sera néanmoins libre de ne pas satisfaire sa demande et de désigner un autre administrateur.
Maintien de la rémunération
D’autre part, le chef d’une entreprise ou le dirigeant d’une société placée en redressement judiciaire verra, par principe, sa rémunération maintenue en l’état. Jusqu’à maintenant, sa rémunération était fixée par le juge-commissaire. Sachant que ce dernier garde la possibilité, à la demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public, de changer la rémunération du dirigeant.
À noter : en cas de liquidation judiciaire, c’est toujours le juge-commissaire qui fixe la rémunération du chef d’entreprise pendant la procédure.
Art. 56 et 58, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23
© Les Echos Publishing 2019

Zoom sur les associations devant respecter les règles de la commande publique.
Les acheteurs contraints d’appliquer le Code de la commande publique pour leur passation de marchés (les « pouvoirs adjudicateurs ») sont généralement des personnes morales de droit public (État, communes, régions…). Mais une association peut, lorsqu’elle présente certaines caractéristiques, être, elle aussi, un pouvoir adjudicateur contraint, dès lors, de se soumettre à ce Code pour ses marchés.
Précision : les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés sans publicité, ni mise en concurrence préalables lorsque le respect de la procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire à leurs intérêts (valeur inférieure à 25 000 € HT, urgence, première procédure infructueuse…).
La satisfaction de besoins d’intérêt général
Une association est un pouvoir adjudicateur lorsqu’elle a été « créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ».
Étant précisé qu’il est tenu compte non pas de l’activité confiée au moment de sa création, mais de celle effectivement exercée.
Par ailleurs, « spécifiquement » ne veut pas dire « exclusivement » ou « majoritairement » : la satisfaction des besoins d’intérêt général peut constituer une part peu importante de l’activité.
Enfin, les « besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial » recouvrent des activités qui profitent à la collectivité, qu’une personne publique pourrait prendre à sa charge et qui sont satisfaits d’une manière autre que par l’offre de biens ou de services sur le marché.
Un a étroit avec un pouvoir adjudicateur
L’association doit également remplir un des critères suivants :– son activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur : plus de la moitié de ses revenus proviennent de financements versés sans contrepartie par des personnes morales de droit public ;– sa gestion est soumise au contrôle d’un pouvoir adjudicateur : ce dernier exerce un contrôle actif permettant d’influencer les décisions de l’association ;– plus de la moitié des membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par un pouvoir adjudicateur.
À savoir : la passation des marchés publics est dématérialisée. Les associations pouvoirs adjudicateurs doivent mettre en place une plate-forme de dématérialisation (un « profil d’acheteur ») pour publier les documents de la consultation des marchés dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 € HT, réceptionner les documents des candidats et échanger avec eux. Pour plus d’informations, elles peuvent se référer au « Guide très pratique de la dématérialisation pour les acheteurs » publié sur le site www.economie.gouv.fr/daj.
© Les Echos Publishing 2019

Selon un sondage, 89 % des Français possèdent un produit d’épargne.
OpinionWay s’est récemment intéressé au comportement des Français vis-à-vis de leur épargne. À en croire ce sondage réalisé auprès de 2 470 personnes âgées de 18 ans et plus, 89 % des Français possèdent un produit d’épargne. Ils sont même 67 % à en posséder plusieurs. Sans surprise, c’est le Livret A qui est le plus souscrit malgré sa faible rentabilité (taux d’intérêt de 0,75 %). Sur ces véhicules de placement, les Français épargnent en moyenne 44 217 €. Mais, fait marquant, ils sont 69 % à ne pas savoir combien leur épargne leur rapporte !
Consultés sur leurs motivations à épargner, les Français répondent à 46 % mettre de côté pour pouvoir faire face aux imprévus du quotidien (remplacement d’appareil ménager…). Vient ensuite à 24 % la possibilité de dissocier ses économies du compte courant. Puis, le financement de projets à long terme pour 22 % (achat immobilier, préparation de la retraite, financement des études des enfants…). Et pour 7 %, l’épargne accumulée serait dédiée pour des projets de court terme (voyage, financement d’une voiture).
© Les Echos Publishing 2019

Une entreprise peut valablement rompre une relation commerciale établie sans accorder de préavis à son partenaire lorsque ce dernier a commis une faute grave.
Tout producteur, distributeur ou prestataire de services qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner à son partenaire un préavis écrit d’une durée suffisamment longue engage sa responsabilité et peut donc être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.
Précision : la durée minimale du préavis doit être fixée au regard notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou, s’ils existent, aux accords interprofessionnels. En pratique, les tribunaux ont également tendance à prendre en compte la nature de la relation commerciale entretenue par les parties (volume d’affaires, état de dépendance économique de la victime, obligation d’exclusivité, etc.). Sachant que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée pour cause de durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.
Une faute grave
Toutefois, une entreprise est en droit de rompre une relation commerciale établie sans préavis en cas de manquement grave de l’autre partie à ses obligations essentielles.
C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente. En 2005, une société spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques était entrée en relation d’affaires avec un prestataire qui proposait un accès payant à différents services en ligne. Une relation qui avait duré jusqu’en 2013, date à laquelle la première société y avait mis fin, sans accorder de préavis. Le prestataire victime de la rupture avait alors invoqué une rupture brutale d’une relation commerciale établie et demandé réparation du préjudice subi à ce titre.
Si le caractère établi de la relation commerciale ne faisait pas le moindre doute, les juges ont néanmoins estimé que la rupture ne pouvait pas être considérée comme brutale. En effet, le prestataire n’avait pas payé, depuis 2010, des factures pour un montant total de plus de 300 000 €, ce qui constituait, aux yeux des juges, un manquement grave à ses obligations essentielles justifiant la rupture sans préavis.
À noter : le prestataire avait fait valoir que le fait de ne pas être à jour des paiements ne constituait pas une faute grave autorisant une rupture sans préavis. Les juges n’ont pas été sensibles à cet argument.
Cassation commerciale, 27 mars 2019, n° 17-16548
© Les Echos Publishing 2019

Au 2 semestre 2019, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,87 % pour les créances dues aux professionnels.
Pour le 2e semestre 2019, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 3,26 % pour les créances dues aux particuliers ;– 0,87 % pour les créances dues aux professionnels.
Il varie donc légèrement par rapport à celui du 1er semestre 2019 (respectivement 3,40 % et 0,86 %).
Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.
Ce taux sert notamment à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus par un débiteur défaillant après mise en demeure. Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,61 % à partir du 1er juillet 2019.
Arrêté du 26 juin 2018, JO du 27
© Les Echos Publishing 2019

Les dirigeants associatifs doivent toujours se référer aux statuts avant de prendre une décision.
Les règles de fonctionnement des associations sont essentiellement fixées par leurs statuts et, le cas échéant, par leur règlement intérieur. Et la Cour de cassation vient de rappeler l’importance de respecter ces textes fondateurs !
Dans cette affaire, le président d’une association sportive de tir avait, par écrit, informé un de ses membres que son adhésion ne serait pas renouvelée pour l’année en cours et les années suivantes. Une décision prise après consultation du comité directeur de l’association et justifiée par le non-respect par l’intéressé du règlement intérieur et par des pratiques dangereuses. Ce dernier avait alors demandé aux tribunaux sa réintégration au sein de l’association ainsi que des dommages-intérêts.
La cour d’appel avait rejeté cette demande. En effet, elle avait estimé que la décision du président de l’association de refuser le renouvellement de la licence de tir de ce sportif était légitime puisque celui-ci avait volontairement contrevenu au règlement intérieur.
Mais, pour la Cour de cassation, la cour d’appel aurait surtout dû vérifier les pouvoirs accordés au président par les statuts ! Ainsi, elle aurait dû s’assurer que « les statuts de l’association conféraient à son président le pouvoir de s’opposer au renouvellement de l’adhésion de l’un de ses membres ». Comme elle ne l’a pas fait, son arrêt a donc été cassé et l’affaire renvoyée devant une autre cour pour être rejugée.
Cassation civile 1re, 15 mai 2019, n° 18-18167
© Les Echos Publishing 2019
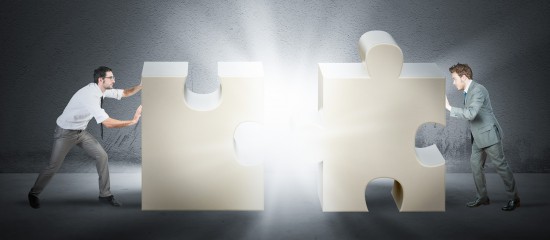
Les modalités d’approbation d’une opération de fusion par une société absorbante sont assouplies.
La procédure d’approbation des fusions de sociétés est assouplie.
Délégation de compétence pour les opérations de fusion
Lorsqu’une société par actions absorbe une autre société, ses actionnaires doivent approuver l’opération.
À ce titre, pour éviter d’avoir à se réunir notamment pour approuver un projet de fusion qui consiste en l’absorption d’une société dont la valeur est peu importante par rapport à celle de la société absorbante, l’assemblée générale extraordinaire d’une société par actions peut désormais déléguer au conseil d’administration (ou au directoire) le pouvoir de décider de procéder à une fusion par absorption, et ce pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder 26 mois.
Elle peut également déléguer au conseil d’administration (ou au directoire) le pouvoir de déterminer les modalités définitives du projet de fusion pour une durée qui, cette fois, ne peut excéder 5 ans.
Et si l’opération nécessite une augmentation de capital, l’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire son pouvoir de décider cette augmentation permettant d’attribuer des titres aux associés de la société absorbée.
Sachant qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ou du projet de fusion.
Suppression de la déclaration de conformité pour les SAS et les SCA
D’autre part, les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA) qui participent à une fusion ou à une scission n’ont plus à déposer de déclaration de conformité au greffe du tribunal de commerce.
Si les SARL, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple qui participent à une fusion ou à une scission étaient déjà dispensées d’établir une déclaration de conformité, un doute demeurait pour les sociétés par actions simplifiées (SAS) et les sociétés en commandite par actions (SCA). Ce doute est désormais levé. L’obligation de déposer une déclaration de conformité ne s’impose donc plus qu’aux sociétés anonymes (SA).
Rappel : la déclaration de conformité relate tous les actes accomplis en vue de procéder à la fusion ou à la scission des sociétés concernées et contient l’affirmation que l’opération a été réalisée en conformité avec la loi et les règlements.
Art. 101 et 102, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23
© Les Echos Publishing 2019