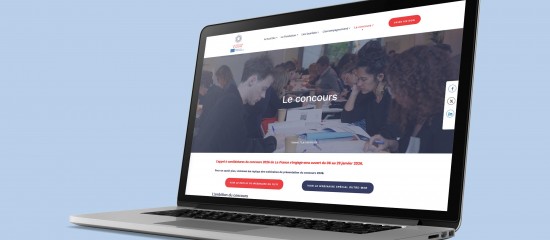Les prochains soldes d’hiver se dérouleront du mercredi 7 janvier au mardi 3 février 2026. L’occasion de rappeler les règles que les commerçants doivent respecter lorsqu’ils organisent ces opérations souvent très attendues par les consommateurs. Des règles qui sont plus strictes que celles régissant les promotions.
Les soldes sont définis par la loi comme « des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à écouler de manière accélérée des marchandises en stock ».
Ainsi, trois éléments caractérisent les soldes. Les commerçants qui organisent des soldes doivent donc respecter ces conditions.
Ainsi, d’une part, ils doivent faire l’objet d’une publicité qui précise la date de début des opérations, ainsi que, le cas échéant, la nature des marchandises sur lesquelles ils portent.
D’autre part, durant les soldes, les marchandises doivent évidemment être proposées aux consommateurs à un prix plus faible qu’auparavant. À ce titre, le commerçant est tenu d’indiquer, sur chaque article soldé, le prix de référence barré (c’est-à-dire le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédents le début des soldes), le nouveau prix réduit et le taux de réduction appliqué. Et la distinction entre les articles soldés et les articles non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs.
Enfin, les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes.
Précision : un article en solde bénéficie des mêmes garanties que tout autre article (service après-vente, défaut de conformité, vice caché…). Les limites de garantie sur les produits soldés sont donc interdites. Ainsi, en cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l’article ou de le rembourser. Et en cas de défaut de conformité identifié dans les 2 ans après l’achat, le vendeur est tenu de proposer au consommateur de réparer ou de remplacer le bien ou, si aucune de ces 2 options n’est possible, de le rembourser. Dans les autres cas, le commerçant n’est pas tenu juridiquement de procéder à l’échange ou au remboursement, mais il peut le faire à titre purement commercial. En tout état de cause, le commerçant est tenu d’appliquer les dispositions relatives à l’échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d’affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d’autres supports.
En pratique, aucune formalité particulière ne doit être accomplie pour organiser des soldes. Et un commerçant n’est pas tenu d’en organiser.
Attention : est puni d’une peine d’amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales le fait :
Les soldes ont lieu deux fois par an, en été et en hiver, au cours de deux périodes de 4 semaines chacune, uniformément déterminées pour l’ensemble du territoire national.
Plus précisément, les soldes d’hiver commencent le 2
Ainsi, en 2026, les soldes d’hiver auront lieu du mercredi 7 janvier au mardi 3 février.
Les soldes d’été débutent, quant à eux, le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures, la date étant avancée à l’avant-dernier mercredi lorsque le dernier mercredi tombe après le 28 juin. En 2026, ce sera donc du mercredi 24 juin au mardi 21 juillet.
Précision : ces dates s’appliquent également aux ventes réalisées sur Internet, quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise.
Sachant toutefois que des dates spécifiques sont prévues pour certains départements frontaliers ou touristiques et en outre-mer (sauf à Mayotte et en Guyane où les soldes ont lieu aux mêmes dates qu’en métropole).
Pour les soldes d’hiver, le début des opérations est fixé au :
Pour les soldes d’été, le début des opérations est fixé au :
Les promotions, quant à elles, sont utilisées par les commerçants pour dynamiser les ventes de certains produits, et non pas pour écouler les stocks. Elles ne font pas l’objet d’une règlementation particulière. Mais elles ne doivent pas constituer une pratique commerciale déloyale.
Les promotions peuvent avoir lieu n’importe quand pendant l’année, mais attention elles doivent être occasionnelles et de courte durée. À ce titre, cette durée doit être clairement indiquée par le commerçant dans son magasin, sur ses prospectus et affiches ainsi que sur la publicité faite sur son site internet.
Elles peuvent être réservées à une partie seulement de la cdivtèle, par exemple les cdivts habituels titulaires d’une carte de fidélité.
Et contrairement aux soldes, les articles en promotion doivent être disponibles, au prix annoncé, pendant toute la durée de l’opération. Si le produit n’est plus disponible, le commerçant doit donc se réapprovisionner, sauf s’il a limité sa promotion à un nombre restreint de produits. Dans ce dernier cas, il doit clairement l’indiquer (par exemple, par la mention « jusqu’à épuisement des stocks» ).
Les promotions peuvent consister en une réduction de prix, par exemple dans le cadre de ventes privées, de ventes « flash » ou encore du fameux « Black friday ». Il peut également s’agir d’opérations du type « un produit acheté, un produit offert ». Comme pour les produits soldés, le commerçant doit indiquer clairement le prix antérieur, c’est-à-dire le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours avant l’application de la réduction. Toutefois, ce principe n’est pas applicable en cas de réductions de prix successives pratiquées pendant une période déterminée, le prix antérieur à afficher étant alors celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.
Attention : les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires, des produits de grande consommation, notamment les produits d’hygiène et d’entretien, et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées. Ainsi, les promotions sur les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Pour les produits de grande consommation, cette limite est de 40 %. Cette mesure est applicable jusqu’au 15 avril 2028.
Comme pour les produits soldés, les articles en promotion bénéficient des mêmes garanties que tout autre article (service après-vente, défaut de conformité, vice caché…). Les limites de garantie sur les produits en promo sont donc interdites. Ainsi, en cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l’article ou de le rembourser. Et en cas de défaut de conformité identifié dans les 2 ans après l’achat, le vendeur est tenu de proposer au consommateur de réparer ou de remplacer le bien ou, si aucune de ces 2 options n’est possible, de le rembourser. Dans les autres cas, le commerçant n’est pas tenu juridiquement de procéder à l’échange ou au remboursement, mais il peut le faire à titre purement commercial. En tout état de cause, le commerçant est tenu d’appliquer les dispositions relatives à l’échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d’affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d’autres supports.
© Les Echos Publishing 2025