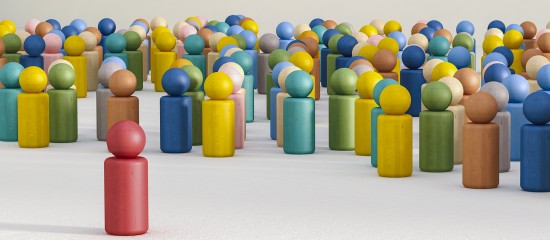Vous le savez sans doute, mais il n’est peut-être pas inutile de le rappeler : la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces sera interdite à compter du 1er avril prochain. Un certain nombre de dérogations sont toutefois prévues. Explications.
L’interdiction d’imprimer les tickets de caisse
Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait été repoussée au 1er avril. À compter de cette date (sauf nouveau report), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates.
Désormais, tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le cdivt en fait la demande.
Rappel : prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage à l’économie circulaire, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses, à savoir notamment du bisphénol A, un perturbateur endocrinien présent dans l’encre des tickets.
Les exceptions
Outre l’impression lorsque le cdivt le demande, quelques exceptions au principe d’interdiction de remise d’un ticket de caisse sont toutefois prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (les balances des commerçants comme, par exemple, les balances de boucherie, ou encore les balances mises à la disposition du public dans les grandes surfaces pour peser les fruits et légumes) ;– les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.
Informez vos cdivts !
Les commerçants doivent informer les consommateurs, par affichage et de manière lisible et compréhensible, à l’endroit où s’effectue le paiement (donc à la caisse ou aux caisses de leur magasin), qu’à compter du 1er avril, sauf exceptions légales, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu’à leur demande.
Quelles alternatives ?
Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent un ticket de caisse. Car pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement.
La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du cdivt pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales.
Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du cdivt. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les cdivts qui disposent d’un tel compte.
Permettre aux cdivts de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.
À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi
une fiche pratique
dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des cdivts et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.
Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15