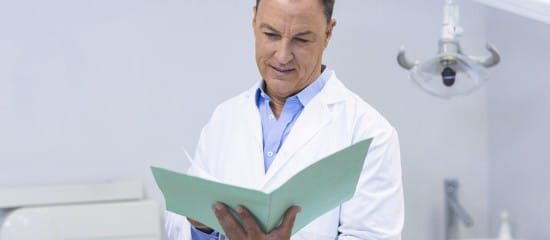Venant en complément du fonds de solidarité, un dispositif d’aide, dite « coûts fixes », a été mis en place au début de l’année 2021 pour couvrir les charges supportées chaque mois par certaines entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire.
L’aide servie à ce titre s’élève à 70 % du montant des charges fixes pour les entreprises de plus de 50 salariés et à 90 % du montant de ces charges pour les entreprises de moins de 50 salariés. La période au titre de laquelle elle peut être demandée peut être mensuelle ou bimestrielle, voire semestrielle, selon l’option choisie par l’entreprise.
Rappelons que cette aide s’adresse aux entreprises qui réalisent, en moyenne, plus de 1 million d’euros de chiffre d’affaires (CA) mensuel et qui :– ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;– ou appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs S1 bis) ;– ou exploitent un commerce dans une commune de montagne affectée par la fermeture des remontées mécaniques ou dans un centre commercial ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.
En outre, ces entreprises doivent percevoir le fonds de solidarité, avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période de référence et enregistrer un excédent brut d’exploitation négatif pendant cette même période.
Peuvent également bénéficier de l’aide « coûts fixes », sans condition de chiffre d’affaires, les entreprises de plus petite taille qui ont des charges fixes très élevées et qui appartiennent à l’un des secteurs suivants : hôtels, restauration traditionnelle et résidences de tourisme des stations de montagne, salles de sport, salles de loisirs intérieurs, jardins zoologiques, établissements de thermalisme, parcs d’attractions et parcs à thèmes, location d’articles de loisirs et de sport ou de commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski, discothèques.
Ce dispositif vient d’être élargi aux entreprises récemment créées et d’être prolongé de 2 mois.
L’aide ouverte aux entreprises récentes
Jusqu’alors, seules les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 pouvaient bénéficier de l’aide « coûts fixes ».
Désormais, celles créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 peuvent également y avoir droit. Pour cela, elles doivent remplir les mêmes conditions que celles exigées des entreprises initialement éligibles à l’aide, et notamment avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période au titre de laquelle l’aide est demandée.
Cette aide couvre la période allant du 1er janvier 2021 (ou, à défaut, la date de création de l’entreprise) au 30 juin 2021.
En pratique : ces entreprises doivent demander l’aide entre le 15 août et le 30 septembre 2021. La demande devant être déposée par voie dématérialisée sur le site www.impots.gouv.fr via l’espace professionnel de l’entreprise. Elle doit être accompagnée d’un certain nombre de justificatifs parmi lesquels une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle remplit les conditions d’éligibilité à l’aide et que les informations déclarées sont exactes ainsi qu’une attestation d’un expert-comptable.
L’aide prolongée jusqu’au mois d’août
Initialement, l’aide « coûts fixes » avait été instaurée pour le 1er semestre 2021, la période d’éligibilité étant le bimestre (janvier-février 2021, mars-avril 2021, mai-juin 2021) ou le mois (avril 2021, mai 2021…). Elle vient d’être prolongée de 2 mois supplémentaires, donc jusqu’en août 2021. Les conditions pour en bénéficier étant inchangées.
En pratique : pour les mois de juillet et d’août 2021, la demande pour bénéficier de l’aide devra être déposée dans un délai de 45 jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’août 2021.
Décret n° 2020-943 du 16 juillet 2021, JO du 17
Décret n° 2021-1086 du 16 août 2021, JO du 17