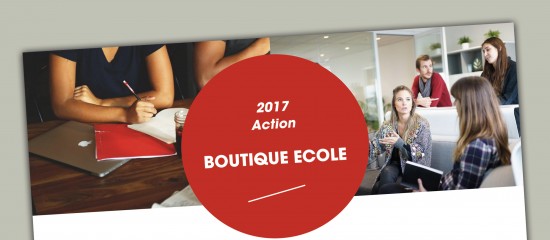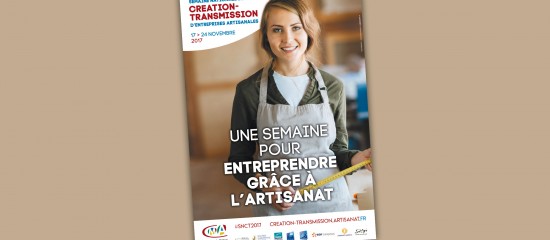38 % des jeunes créateurs d’entreprise envisagent de financer leur projet via une plate-forme de financement participatif.
Baptisé « les jeunes et l’entrepreneuriat », un récent sondage, réalisé par OpinionWay pour Ulule auprès d’un échantillon représentatif de la population âgée de 18 à 35 ans, met en lumière que 54 % des personnes interrogées ont déjà eu envie de créer leur entreprise ou à 27 % d’en reprendre une. Et si 33 % d’entre elles estiment « qu’il s’agit plutôt d’un rêve que d’un projet précis », 21 % affirment y avoir réfléchi concrètement ou être déjà en phase de création.
Le recours au financement participatif
Lorsqu’on les interroge sur les moyens qu’ils entendent mettre en œuvre pour financer leur projet, sans surprise, les jeunes créateurs d’entreprise répondent à 70 % l’emprunt bancaire et à 61 % un apport personnel. Seuls 30 % d’entre eux comptent sur des aides et des financements publics et 9 % sur les apports des business angels. En revanche, fait nouveau, 38 % de ces jeunes créateurs envisagent de privilégier les plates-formes de crowdfunding pour entamer, voire boucler leur financement. Interrogés sur les atouts du financement participatif comparé au financement bancaire, 54 % jugent qu’il « donne davantage sa chance aux projets innovants », 37 % qu’il est plus simple à mobiliser et 32 % qu’il est « plus adapté au lancement de son projet ». A contrario, pour 53 % des personnes interrogées, le financement bancaire est considéré comme étant plus fiable. 46 % des jeunes créateurs d’entreprise estiment, en outre, qu’il permet d’obtenir des montants financiers plus importants.
Enfin, 59 % des personnes interrogées envisagent de cumuler les deux modes de financement s’ils venaient à créer une entreprise.
Pour rappel, en 2016, près de 97 M€ de prêt et 69 M€ d’investissement ont été mobilisés en France via des plates-formes de crowdfunding, selon le baromètre publié par l’association professionnelle Financement Participatif France.
© Les Echos Publishing 2017

Selon un récent sondage OpinionWay, plus d’un étudiant sur trois envisage de se lancer dans l’aventure de la création d’entreprise. Néanmoins, des freins importants persistent.
Les étudiants sont de plus en plus séduits par l’idée de créer leur entreprise : c’est ce que révèle un récent sondage OpinonWay, réalisé pour Moovjee (Mouvement pour les Jeunes et les Étudiants Entrepreneurs), le réseau bancaire CIC et l’Agence France Entrepreneur (AFE).
D’après les chiffres publiés, l’entrepreneuriat bénéficie, en effet, d’une très bonne perception générale auprès des jeunes sondés. 44 % imaginent l’entrepreneur comme quelqu’un de passionné, 43 % le voient comme un leader et 36 % comme une personne créative. 36 % des répondants envisagent eux-mêmes de créer une entreprise (+2 % par rapport à l’étude précédente, réalisée en 2015), et ce, pour 20 % d’entre eux, soit pendant, soit juste après les études (+7 %).
Interrogés sur les motivations qui les poussent à devenir chef d’entreprise, 87 % évoquent l’envie d’être libres de leurs décisions, de se faire leurs propres expériences (87 %) ou encore de montrer tout leur potentiel (85 %). En somme : la perspective de travailler différemment, en dehors de la sphère « classique » du salariat.
Néanmoins, malgré cet enthousiasme apparent pour l’aventure entrepreneuriale, force est de constater que des freins persistent. Pour 95 % des jeunes interrogés, la création d’entreprise soulève, en effet, bon nombre de difficultés qu’il s’agit de surmonter. Parmi les obstacles les plus fréquemment cités : des moyens financiers limités (71 %) ainsi qu’un manque d’expérience (50 %).
Pour en savoir plus et consulter le détail du sondage « Les étudiants et l’entrepreneuriat », rendez-vous sur : www.moovjee.fr
© Les Echos Publishing 2017

Après un mois de septembre relativement stable, les derniers chiffres publiés par l’Insee indiquent une augmentation de 2,6 % du nombre de créations d’entreprises en France au mois d’octobre 2017.
D’après les derniers chiffres publiés par l’Insee, 51 547 créations d’entreprises ont été enregistrées au mois d’octobre 2017 : +2,6 % par rapport au mois de septembre, tous types d’entreprises confondus. Selon l’Institut, cette évolution s’explique non seulement par une augmentation importante du nombre de créations d’entreprises classiques (+4,2 %), mais aussi par un léger redressement au niveau des immatriculations de micro-entrepreneurs (+0,3 %).
Sur la période août-septembre-octobre, les chiffres témoignent d’une accélération encore plus forte du nombre cumulé de créations d’entreprises en France : par rapport au même trimestre de l’année dernière, le nombre de créations brutes a ainsi progressé de 10,6 %, dont +13,8 % pour les immatriculations de micro-entrepreneurs, +9,9 % pour les entreprises individuelles classiques et +6,8 % pour les sociétés. Une fois de plus, ce sont les secteurs du soutien aux entreprises et du commerce qui contribuent le plus à cette hausse globale.
Enfin, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des 12 derniers mois continue également de s’accélérer. L’Insee constate ainsi une augmentation de 5,3 % du nombre cumulé de créations brutes par rapport aux 12 mois précédents : une évolution qui s’explique à la fois par une hausse significative du côté des créations de sociétés (+5,8 %), des immatriculations de micro-entrepreneurs (+5,2 %) et des créations d’entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs (+4,8 %).
Pour consulter des données complémentaires, rendez-vous sur : www.insee.fr
© Les Echos Publishing 2017

Téléchargeable via le site web de l’Agence France Entrepreneur (AFE), le petit guide « Décrire son modèle économique » tend à aider les futurs entrepreneurs à formuler leur stratégie de rentabilité.
Comment ma future entreprise va-t-elle générer de la rentabilité ? Quelle est mon offre ? À qui s’adresse-t-elle ? Quels sont les canaux de distribution et de communication dont je compte me servir ? Élément incontournable de chaque business plan, la définition du modèle économique représente une étape pour le moins cruciale du parcours entrepreneurial.
Pour amener les porteurs de projets à se poser les bonnes questions, l’Agence France Entrepreneur (AFE) a récemment publié un petit guide gratuit. Téléchargeable via le site web de l’organisme, ce dernier s’appuie sur une méthode développée par Alexander Osterwalder et Yves Pigneur, auteurs du livre « Business Model : Nouvelle Génération ».
Offre, activités clés, partenaires, cats, ressources, coûts, revenus… Baptisée « Business Model Canvas », la démarche proposée consiste notamment à réunir, sur une seule page, l’ensemble des critères définissant le modèle économique de la future entreprise. En remplissant une grille composée de 9 briques, traduisant les principaux aspects économiques de l’activité, les porteurs de projets seront ainsi amenés à définir leurs priorités, tout en évaluant le potentiel de leur idée.
Pour en savoir plus et télécharger le petit guide gratuit, rendez-vous sur : www.afecreation.fr
© Les Echos Publishing 2017
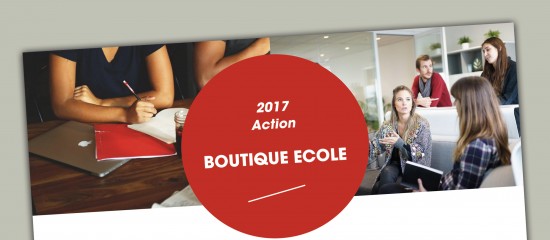
Le réseau d’accompagnement à la création d’entreprise BGE Loiret a récemment inauguré sa première boutique école, dédiée à la formation des porteurs de projets envisageant une activité commerciale.
Une boutique école implantée au cœur du centre-ville d’Orléans. Parce que le métier de commerçant ne s’improvise pas, le réseau de soutien à la création d’entreprise BGE Loiret a récemment ouvert son premier lieu de formation grandeur nature. Baptisé « Boutik’école » et animé en partenariat avec la couveuse d’entreprises PES 45, ce dernier tend à accompagner des porteurs de projets envisageant de créer une entreprise dans le domaine du commerce.
Organiser une boutique, gérer un stock, agencer une vitrine, mettre en valeur les produits, communiquer sur son offre, conseiller les cats… Installé dans un local commercial mis à disposition par la ville d’Orléans, le nouveau dispositif réunit, en pratique, 4 stagiaires pour des séances de formation d’une durée de 6 semaines. L’occasion, pour les participants, de se mettre en situation et d’expérimenter le quotidien d’un commerçant, tout en étant encadrés par une équipe d’experts !
Une école au plus près du terrain et une approche pédagogique qui conjugue théorie et pratique : de quoi permettre aux futurs entrepreneurs d’agréger les compétences nécessaires pour valider leur projet et, pourquoi pas, acquérir leurs premiers cats !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.pes45.org
© Les Echos Publishing 2017

Un récent arrêté vient de préciser 3 nouvelles actions d’accompagnement permettant aux futurs artisans de bénéficier d’une dispense du stage de préparation à l’installation.
Si les futurs artisans doivent, en principe, suivre un stage de préparation à l’installation (SPI) d’une durée de 4 à 5 jours avant de pouvoir s’immatriculer au répertoire des métiers, cette obligation avait néanmoins été assouplie, fin 2016, par la loi Sapin II.
Définies par arrêté, pas moins de 15 formations (dont, notamment, plusieurs BTS et DUT) et 4 actions d’accompagnement, proposées par des réseaux d’aide à la création d’entreprise, pouvaient ainsi déjà permettre aux futurs chefs d’entreprise d’être dispensés du SPI.
Cette première liste a récemment été complétée par la publication d’un nouvel arrêté, entré en vigueur le 1er octobre 2017, précisant 3 autres actions d’accompagnement pouvant également remplacer le stage de préparation à l’installation, à savoir :
–
« Je deviens entrepreneur » (Association pour le droit à l’initiative économique – Adie) ;
–
« Développer un projet entrepreneurial réussi » (Chambres de commerce et d’industrie – CCI France) ;
–
« Repreneur d’entreprise » (CCI France).
En pratique, ce nouvel arrêté tend ainsi à poursuivre la simplification des démarches auxquelles sont soumis les futurs artisans dans le cadre de leur installation professionnelle.
Arrêté du 25 septembre 2017, JO du 30
© Les Echos Publishing 2017
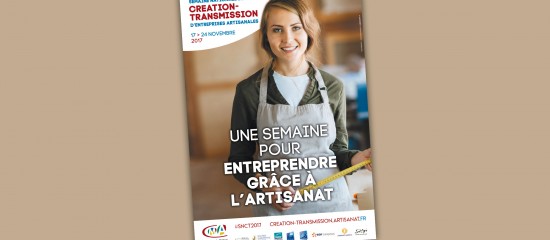
Organisée par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA), la 17 Semaine nationale de la création-transmission d’entreprises artisanales se tiendra du 17 au 24 novembre 2017.
La 17e édition de la Semaine nationale de la création-transmission d’entreprises artisanales se tiendra du vendredi 17 au vendredi 24 novembre 2017 dans toute la France.
Organisé par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (CMA) et ouvert à toutes les personnes intéressées par le sujet – qu’ils soient créateurs d’entreprise, déjà installés ou en devenir, cédants ou repreneurs – l’évènement offre un large choix de rendez-vous instructifs et enrichissants.
Salons, journées portes ouvertes, conférences, forums, tables rondes… Autant d’occasions de faire le plein d’informations sur les différentes opportunités offertes par le secteur de l’artisanat ! Sans compter la présence des conseillers du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, disponibles pour échanger avec les porteurs de projets sur les divers enjeux du développement d’une entreprise, de la création (ou de la reprise) jusqu’à la transmission.
Pour en savoir plus, rendez-vous dès à présent sur : creation-transmission.artisanat.fr
© Les Echos Publishing 2017

Destiné aux structures publiques ou privées spécialisées dans l’accompagnement des entrepreneurs, l’appel à projets lancé par Nantes Métropole et l’AFE est ouvert jusqu’au 1 décembre 2017.
Afin d’amplifier les actions engagées dans le cadre du dispositif « Osez Entreprendre », dédié à la création d’entreprises dans les quartiers prioritaires, la communauté urbaine Nantes Métropole et l’Agence France Entrepreneur (AFE)ont récemment lancé un appel à projets à destination des structures publiques ou privées spécialisées dans l’accompagnement des porteurs de projets.
L’enjeu ? Renforcer l’accompagnement des créateurs-repreneurs et des jeunes dirigeants d’entreprise, accroître le taux de création et de reprise d’entreprises et, enfin, favoriser la pérennité des entreprises et des emplois créés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour cela, une enveloppe maximale de 780 000 € se verra accorder à l’appel à projets au titre de la période 2018-2020.
À travers cette initiative, les deux partenaires tendent à faire émerger de nouveaux dispositifs favorisant l’acquisition de compétences entrepreneuriales et la mise en réseau, et ce notamment pour les moins de 30 ans et les femmes créatrices d’entreprise. L’objectif étant d’accompagner, chaque année, environ 150 porteurs de projets et pas moins de 100 chefs d’entreprise ayant choisi d’implanter leur activité dans l’un des 15 quartiers de la politique de la ville de l’agglomération nantaise.
La date limite pour la remise des dossiers a été fixée au 1er décembre 2017 à 12h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.nantesmetropole.fr
© Les Echos Publishing 2017

À travers la signature d’un accord-cadre avec le Secrétariat d’État en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes, BNP Paribas officialise son plan d’action en faveur de l’entrepreneuriat féminin.
Promouvoir et encourager l’entrepreneuriat féminin. Récemment signé par le groupe bancaire BNP Paribas et le Secrétariat d’État en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes, un nouvel accord-cadre précise une série engagements concrets au travers d’un plan d’action ambitieux.
En pratique, plusieurs leviers d’action ont ainsi été définis :
– soutenir les entrepreneures, et ce quel que soit le stade de développement de leur activité : de la création jusqu’à la croissance de l’entreprise, en passant par la phase de consolidation ;
– mobiliser les Directions régionales du groupe bancaire pour favoriser la signature de plans d’actions régionaux encourageant l’entrepreneuriat féminin ;
– assurer la montée en compétences des chargé(e)s d’affaires BNP Paribas dédié(e)s à l’entrepreneuriat féminin sur l’ensemble du territoire français ;
– accompagner les entrepreneures grâce à des ateliers thématiques baptisés « Connect and Change » et des opérations de networking ;
– intégrer et valoriser l’entrepreneuriat féminin dans la politique d’innovation et d’engagement d’entreprise du groupe bancaire.
Enfin, BNP Paribas prévoit la réalisation prochaine d’une étude spécifiquement dédiée aux femmes entrepreneures. Selon le groupe bancaire, ce travail de terrain serait mené en collaboration étroite avec l’école de commerce Grenoble École de Management.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.group.bnpparibas
© Les Echos Publishing 2017

Suite à un recours porté devant la justice par des associations de professionnels de l’immobilier, le Tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du préfet du département du Nord fixant les loyers de référence. Des loyers de référence essentiels pour rendre l’encadrement des loyers effectif.
Coup dur pour l’encadrement des loyers ! Le tribunal administratif vient d’annuler le dispositif à Lille, seule ville à s’être placée volontairement sous cette nouvelle réglementation.
Saisie en la matière par l’Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) Nord de France, l’Union des syndicats de l’immobilier et la Fédération nationale de l’immobilier, le tribunal a motivé sa décision par le fait que le dispositif, mis en œuvre par un arrêté du préfet du département du Nord, ne pouvait pas être appliqué à la seule commune de Lille, mais devait l’être à l’ensemble de l’agglomération lilloise, qui comprend 59 communes. Cet ensemble devant être regardé comme une seule et même zone tendue.
Rappel : l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à faire baisser le niveau des loyers les plus élevés dans les zones dites « tendues », c’est-à-dire les zones dans lesquelles le manque de logements est le plus important. Pour que le dispositif puisse fonctionner, le préfet de la région concernée communique annuellement différents loyers de référence (par quartier et type de logement) que les propriétaires doivent respecter pour fixer le montant du loyer de leur logement.
Reste à savoir maintenant si la décision du tribunal administratif signe l’arrêt de mort du dispositif à Lille ou si les pouvoirs publics vont tout faire pour appliquer l’encadrement des loyers à l’agglomération lilloise.
© Les Echos Publishing 2017