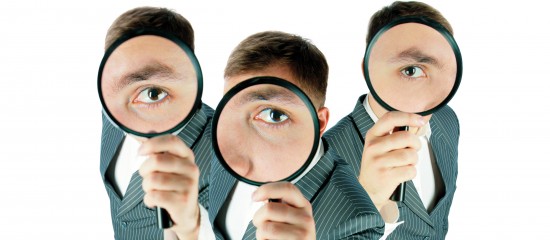Les indemnités compensatoires de handicap naturel ne sont plus prises en compte dans le calcul du bénéfice imposable des exploitants agricoles relevant du régime du micro-BA.
L’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) est une aide versée aux exploitations agricoles situées dans des zones défavorisées (montagne, par exemple) qui vise à compenser les difficultés structurelles auxquelles elles sont confrontées afin d’y maintenir une activité.
Depuis le 1er janvier 2017, cette aide est exclue des recettes prises en compte pour déterminer le bénéfice imposable des exploitants agricoles relevant du régime du micro-BA (bénéfices agricoles). Rappelons que leur bénéfice imposable est égal à la moyenne triennale des recettes HT de l’année d’imposition et des 2 années précédentes, diminuées d’un abattement forfaitaire de 87 % représentatif des charges. Un abattement qui ne peut être inférieur à 305 €.
Précision : sont également exclus des recettes imposables selon le régime du micro-BA les remboursements de charges perçus dans le cadre de l’entraide agricole, les subventions et primes d’équipement, ainsi que les redevances ayant leur origine dans le droit de propriété. Ces dernières sont toutefois imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Sont également exclus les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Ces plus-values sont, en revanche, imposées selon le régime des plus-values professionnelles.
Art. 101, loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, JO du 30
© Les Echos Publishing 2017

Dans certains cas, une association peut être soumise aux impôts commerciaux en raison de l’existence d’une étroite communauté d’intérêts entre elle et une société commerciale.
Suite à une vérification de comptabilité, une association a été soumise aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés et TVA) par l’administration fiscale qui a estimé qu’en raison de l’absence de gestion désintéressée, son activité était lucrative. Une imposition que le Conseil d’État a confirmée. Les juges ont, en effet, estimé que, dans cette affaire, la gestion de l’association n’était pas désintéressée du fait de l’existence d’une étroite communauté d’intérêts entre elle et une société commerciale.
En l’espèce, l’association conseillait des particuliers ou des entrepreneurs individuels dans des litiges avec les administrations et dans des procédures devant les tribunaux. Son activité constituait le prolongement de celle d’une société commerciale, dont le gérant était également le président de l’association, et qui exerçait, pour partie, une activité de prestations d’assistance et de conseil juridique et administratif. Les juges ont notamment relevé qu’une partie des recettes de l’association était encaissée par la société qui émettait les factures correspondantes, que la société prenait en charge le salaire d’une secrétaire qui consacrait la quasi-totalité de son temps de travail à l’association et que de nombreux cats de la société étaient membres de l’association. Selon eux, l’activité de l’association permettait à la société de développer sa propre catèle et sa gestion ne pouvait donc pas présenter un caractère désintéressé.
Conseil d’État, 7 décembre 2016, n° 389299
© Les Echos Publishing 2017

L’administration fiscale a récemment publié les limites d’exonération d’impôt pour la location d’une partie de la résidence du bailleur.
Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu pour les produits issus de la location. Cette exonération s’applique lorsque les pièces sont meublées et constituent la résidence principale du locataire (ou temporaire pour un salarié saisonnier). Condition supplémentaire, le loyer perçu par le bailleur doit être fixé dans des limites raisonnables.
Pour apprécier ce caractère « raisonnable », l’administration fiscale a récemment communiqué les plafonds annuels de loyer à ne pas dépasser pour l’année 2017. Ces plafonds, établis par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, s’élèvent à 184 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Ile-de France, et à 135 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.
BOI-BIC-CHAMP-40-20 du 5 avril 2017
© Les Echos Publishing 2017

En cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire pendant la période d’engagement de location, le maintien de l’avantage fiscal suppose que le propriétaire accomplisse les diligences nécessaires à la relocation de son bien.
Un couple avait investi dans une villa neuve en vue de la mettre en location afin de bénéficier de l’amortissement Périssol. Pour rappel, ce dispositif de défiscalisation immobilière, applicable aux investissements réalisés entre janvier 1996 et août 1999, permet aux propriétaires de déduire de leurs revenus fonciers, par le biais d’un amortissement, jusqu’à 80 % de l’investissement. Cet avantage fiscal est soumis à plusieurs conditions, et notamment à l’engagement de louer le logement pendant 9 ans.
Dans cette affaire, le locataire de la villa avait été expulsé pour défaut de versement des loyers. Malgré l’absence de locataire pendant la période d’engagement de location, le couple avait toutefois continué de déduire les amortissements. En effet, une période de vacance peut être admise, et l’avantage fiscal maintenu, dès lors que le propriétaire accomplit les diligences nécessaires à la relocation de son bien (recours à une agence immobilière, publication d’annonces, etc.).
Mais l’administration fiscale, suivie de la cour d’appel, ont remis en cause les déductions fiscales pratiquées par le couple au motif qu’il n’avait pas fait procéder à des travaux de remise en état de leur villa après le départ du locataire. Ce que vient de censurer le Conseil d’État. Selon les juges, pour refuser l’avantage fiscal, l’administration aurait dû établir que les travaux étaient indispensables à la remise en location du bien immobilier.
Cette solution, rendue au titre de l’amortissement Périssol, devrait être applicable aux autres dispositifs de défiscalisation immobilière dont le bénéfice est soumis à un engagement de location (Duflot, Pinel…).
Conseil d’État, 25 janvier 2017, n° 387034
© Les Echos Publishing 2017

Une erreur de date sur un avis de passage postal peut remettre en cause les redressements envisagés par l’administration fiscale à l’encontre d’une société.
Lorsque l’administration fiscale souhaite corriger les bases d’imposition d’une entreprise suite à une vérification de comptabilité, elle doit lui notifier une proposition de rectification. Proposition qui doit être motivée afin de permettre à l’entreprise de formuler ses observations ou d’accepter les redressements. Cette proposition est généralement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de contestation, il revient à l’administration d’établir que le pli est effectivement parvenu à son destinataire ou qu’il a été régulièrement mis en instance. Pour cela, elle peut se référer à l’avis de réception du pli et à la date de présentation y figurant.
Dans une affaire récente, une proposition de rectification avait été envoyée au dirigeant d’une société par pli recommandé. En son absence, un avis de passage de La Poste avait été déposé dans sa boîte aux lettres. Mais l’avis mentionnait à tort une date de vaine présentation au 1er septembre au lieu du 1er octobre. Le pli n’avait donc pas été retiré par son destinataire, le délai de 15 jours qui lui était imparti étant expiré au 1er octobre pour un pli présenté soi-disant le 1er septembre. Induit en erreur, il avait alors demandé l’annulation des redressements.
Ce que vient de valider le Conseil d’État considérant que le dirigeant, qui n’avait aucun autre élément lui permettant de savoir que la date de l’avis de passage était erronée, avait été privé d’une garantie. Car il ne s’agissait pas ici d’une simple erreur de plume comme le soutenait l’administration fiscale…
Conseil d’État, 24 février 2017, n° 397569
© Les Echos Publishing 2017

Les héritiers peuvent demander à l’administration fiscale d’acquitter les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière de manière différée ou fractionnée moyennant paiement d’intérêts à un taux de 1,6 % en 2017.
Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.
Précision : le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (trois versements espacés de six mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les six mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.
Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », ils sont redevables d’intérêts dont le taux est égal au taux effectif moyen pratiqué par les banques au cours du quatrième trimestre de l’année précédant celle de la demande pour les prêts immobiliers à taux fixe consentis aux particuliers, réduit d’un tiers et arrondi à la première décimale. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1er janvier 2017, le taux est fixé à 1,6 % (1,9 % en 2016). Un taux abaissé à 0,5 % (0,6 % en 2016) pour certaines transmissions d’entreprises.
À noter : depuis 2015, le taux des demandes de paiements fractionnés ou différés n’est plus fixé en fonction du taux d’intérêt légal.
www.impots.gouv.fr
© Les Echos Publishing 2017
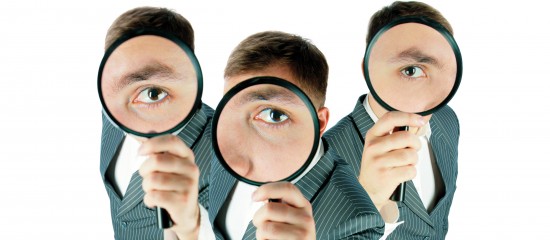
Lorsque l’administration fiscale soupçonne une entreprise d’agissements frauduleux visant à se soustraire aux impôts directs ou aux taxes sur le chiffre d’affaires (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…), elle peut perquisitionner les locaux de cette entreprise afin d’en rechercher les preuves.
Autorisation du juge
Des perquisitions peuvent être réalisées dans les locaux de l’entreprise par l’administration fiscale en cas de présomption de fraude, sur autorisation du juge.
Les cas de soupçons d’agissements frauduleux permettant à l’administration fiscale d’engager une perquisition sont limités par la loi. Il s’agit des cas suivants :– achats ou ventes sans facture ;– utilisation ou délivrance de factures ou de documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;– omission volontaire d’écritures dans des documents comptables obligatoires ;– passer ou faire passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans ces documents.
L’engagement d’une perquisition fiscale est, par ailleurs, subordonné à une autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à perquisitionner. Cette autorisation, délivrée par voie d’ordonnance, fixe le cadre des opérations. Elle doit, par exemple, mentionner la faculté pour l’entreprise de faire appel à un conseil de son choix. Toutefois, le fait de prévenir son conseil ne suspend pas les opérations de perquisition jusqu’à son arrivée. En conséquence, ces dernières peuvent commencer sans la présence effective du conseil. Il est donc important de le prévenir dès le début de la perquisition afin qu’il se déplace rapidement sur les lieux pour contrôler le bon déroulement des opérations.
À noter : lorsque les lieux à perquisitionner sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une perquisition doit être menée de façon simultanée dans ces différents lieux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges territorialement compétents.
Lieux de perquisition
Une perquisition fiscale peut se dérouler en tous lieux.
Une perquisition fiscale peut se dérouler en tous lieux, même privés, dès lors que les pièces et documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d’y être détenus, accessibles ou disponibles. En d’autres termes, les agents du fisc peuvent aussi bien se rendre au siège social d’une entreprise, qu’au domicile de son dirigeant. L’assentiment de ce dernier n’étant pas nécessaire. Il n’est d’ailleurs pas rare que des perquisitions soient menées de façon simultanée dans ces différents lieux. Sachant que les véhicules peuvent être concernés s’ils sont expressément identifiés dans l’ordonnance.
À savoir : l’adresse des lieux à perquisitionner doit être indiquée dans l’ordonnance. Si, au cours de la perquisition, l’administration découvre d’autres lieux susceptibles de contenir les preuves recherchées, elle doit alors solliciter une autorisation complémentaire du juge, accordée par voie d’ordonnance. Toutefois, en cas d’urgence, l’administration peut procéder immédiatement à la visite de ces lieux sur autorisation du juge délivrée par tout moyen.
En pratique, la perquisition ne peut commencer avant 6 heures, ni après 21 heures. Elle est effectuée par les agents du fisc, en présence d’un officier de police judiciaire (OPJ) ainsi que du représentant de l’entreprise – le dirigeant, le plus souvent – ou, à défaut, de deux témoins indépendants requis par l’OPJ.
Opérations sur place
Les agents des impôts peuvent procéder à l’audition du dirigeant et à la saisie de certains documents.
Sur autorisation du juge, les agents des impôts peuvent procéder, sur place, à l’audition du dirigeant, à condition que ce dernier donne son accord. Il peut donc refuser de répondre.
Précision : les renseignements et justifications susceptibles d’être recueillis doivent être liés aux agissements frauduleux présumés décrits dans l’ordonnance du juge. Il peut s’agir de précisions concernant le circuit des marchandises, les relations fournisseurs/cats ou encore le fonctionnement de la caisse. En revanche, l’audition ne peut pas porter sur les pièces et documents saisis.
Et attention, les agents ne sont pas autorisés à recueillir des informations auprès d’autres personnes présentes sur les lieux de la perquisition, comme les salariés de l’entreprise.
Par ailleurs, les agents ne peuvent saisir que les seuls documents de nature à apporter la preuve des agissements frauduleux dont la recherche a été autorisée par le juge. Tous les supports sont toutefois concernés, dont les disques durs. Les agents peuvent également prendre copie de données informatiques présentes sur des serveurs distants, même localisés à l’étranger et appartenant à des sociétés tierces, dès lors que la saisie est opérée à partir d’ordinateurs se trouvant sur les lieux perquisitionnés.
À noter : certains documents, protégés par le secret professionnel, ne peuvent pas être saisis, tels que les consultations adressées par l’avocat de l’entreprise à cette dernière ou les correspondances échangées entre eux.
Les documents saisis doivent ensuite être restitués dans les 6 mois de la perquisition. À défaut, les informations recueillies sont, en principe, inopposables.
À savoir : si le dirigeant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, les agents du fisc peuvent procéder à la copie de ce support. Ils disposent alors de 15 jours, prorogeables sur autorisation du juge, pour accéder à ces informations, en cassant les codes d’accès par exemple. Dans ce cas, l’entreprise encourt l’imposition d’office ainsi qu’une amende.
Voies de recours
L’ordonnance d’autorisation ou le déroulement des opérations de perquisition peuvent faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
Précision : la notification de l’ordonnance s’effectue verbalement et sur place au moment de la visite au dirigeant. En son absence, l’ordonnance est notifiée après la perquisition par lettre recommandée avec avis de réception.
Le déroulement des opérations de perquisition peut également faire l’objet d’un recours devant ce même magistrat, dans un délai de 15 jours à compter de la remise du procès-verbal.
Dans ces deux hypothèses, l’ordonnance rendue par le premier président est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de 15 jours. Mais aucun de ces recours n’est suspensif.
© Les Echos Publishing 2017

Depuis le 30 mars 2017, les entreprises peuvent conserver leurs factures papier sous forme électronique pendant le délai fiscal de 6 ans.
Afin de permettre un contrôle de l’administration fiscale, les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives des opérations réalisées par les entreprises doivent, en principe, être conservés pendant 6 ans. À ce titre, les factures qu’elles émettent ou reçoivent doivent normalement être gardées sous leur forme d’origine. Une tolérance existe néanmoins pour les factures électroniques, lesquelles doivent être conservées sur un support informatique pendant 3 ans, puis sur tout support au choix de l’entreprise pendant les 3 années suivantes.
En revanche, les factures papier ne bénéficiaient, jusqu’à présent, d’aucune dérogation. C’est désormais chose faite ! Depuis le 30 mars 2017, les entreprises peuvent conserver les factures papier sous une forme électronique pendant le délai fiscal de 6 ans. Les factures papier peuvent donc désormais être immédiatement numérisées.
Modalités de numérisation
Les modalités de numérisation que les entreprises doivent respecter ont été fixées par arrêté. Cette numérisation doit notamment garantir la reproduction des factures à l’identique, en tant que copie conforme à l’original en image et en contenu. Elle doit aussi reproduire les couleurs à l’identique en cas de mise en place d’un code couleur. Aucun dispositif de traitements sur l’image n’étant accepté. La numérisation doit également s’opérer sans perte en cas de recours à la compression de fichier.
À noter : chaque fichier numérisé doit être conservé sous format PDF (ou PDF A/3) et être horodaté.
Art. 16, loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, JO du 30
Arrêté du 22 mars 2017, JO du 30
© Les Echos Publishing 2017

Les pouvoirs publics ont communiqué les dates limites de souscription des déclarations de revenus 2016.
Comme chaque année, les contribuables devront bientôt souscrire une déclaration personnelle de revenus et la transmettre au service des impôts. Le calendrier de déclaration des revenus 2016 vient d’être annoncé. Ainsi, les contribuables qui déclarent leurs revenus sous forme papier ont jusqu’au mercredi 17 mai 2017 pour déposer leur déclaration d’ensemble des revenus (formulaire n° 2042 et ses annexes). En cas de déclaration par Internet, ils bénéficient de délais supplémentaires variant selon leur département de résidence. La date limite est ainsi fixée au :– mardi 23 mai 2017 à minuit pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;– mardi 30 mai 2017 à minuit pour les départements n° 20 à 49 ;– mardi 6 juin 2017 à minuit pour les départements n° 50 à 974/976.
Précision : le service de déclaration en ligne sera ouvert à partir du mercredi 12 avril 2017.
Attention, ceux dont le revenu fiscal de référence de 2015 excède 28 000 € devront remplir leur déclaration en ligne dès lors que leur résidence principale dispose d’un accès à Internet.
Service de déclaration
© Les Echos Publishing 2017

Les entreprises ont jusqu’au 18 mai pour télédéclarer leurs résultats.
Quelle que soit la date de clôture de leur exercice, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel doivent télétransmettre leur déclaration de résultats au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Cette année, la déclaration peut donc être déposée jusqu’au 3 mai 2017. Il en va de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Et bonne nouvelle ! Un délai supplémentaire de 15 jours est accordé aux entreprises, qu’elles télédéclarent leurs résultats en ligne (mode EFI) ou par transmission de fichiers (mode EDI). Leur déclaration pourra donc être déposée au plus tard le 18 mai 2017. Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par ce report. Les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent, quant à elles, toujours être souscrites pour le 3 mai 2017 (cf. tableau ci-dessous).
À savoir : les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne clôturent pas leur exercice au 31 décembre doivent déposer leur déclaration de résultats et leur déclaration DECLOYER dans les 3 mois suivant cette clôture. Ces entreprises bénéficient également d’un délai supplémentaire de 15 jours.
| Date limite de dépôt des déclarations |
|
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA)
|
• Déclaration de résultats(régimes réels d’imposition) |
18 mai 2017 |
|
Entreprises à l’impôt sur les sociétés
|
• Déclaration de résultats n° 2065– exercice clos le 31 décembre 2016– absence de clôture d’exercice en 2016 |
18 mai 2017 |
|
Impôts locaux
|
• Déclaration de CFE n° 1447-M• Déclaration n° 1330-CVAE• Déclaration de liquidation et de régularisationde la CVAE 2016 n° 1329-DEF• Déclaration DECLOYER |
3 mai 201718 mai 20173 mai 2017
18 mai 2017 |
|
Taxe sur la valeur ajoutée
|
• Déclaration de régularisation CA12 et CA12A(régime simplifié de TVA)– exercice clos le 31 décembre 2016 |
3 mai 2017 |
|
Sociétés civiles immobilières
|
• Déclaration de résultats n° 2072 |
18 mai 2017 |
|
Sociétés civiles de moyens
|
• Déclaration de résultats n° 2036 |
18 mai 2017 |
|
Associations à l’impôt sur les sociétés aux taux réduits
|
• Déclaration n° 2070 (et paiement)– exercice clos le 31 décembre 2016– absence de clôture en 2016 |
3 mai 2017 |
© Les Echos Publishing 2017