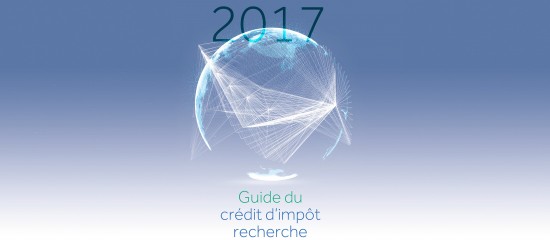Une association peut, sous certaines conditions, rémunérer un ou plusieurs dirigeants sans perdre le caractère désintéressé de sa gestion.
La gestion désintéressée d’une association est l’un des éléments permettant d’établir son absence de caractère lucratif et donc de l’exonérer des impôts commerciaux. Elle suppose notamment que ses dirigeants soient bénévoles. Mais, dans certaines situations, ils peuvent être payés sans remettre en cause sa gestion désintéressée.
Par rémunération du dirigeant, il faut comprendre l’attribution de sommes d’argent et de tout autre avantage par l’association (rémunération des fonctions de dirigeant, d’une autre activité effective au sein de l’association ou de missions ponctuelles, avantages en nature, cadeaux, remboursement forfaitaire de frais…).
Une exception légale pour les grandes associations
Une association peut rémunérer un dirigeant si la moyenne des ressources annuelles de ses trois derniers exercices, excluant celles provenant des personnes morales de droit public, dépasse 200 000 €, deux dirigeants quand elle excède 500 000 € et trois si elle est supérieure à 1 M€. Attention toutefois car l’ensemble des rémunérations perçues par un dirigeant (y compris au sein d’un autre organisme sans but lucratif) ne doit pas excéder, en 2017, 9 807 € par mois.
L’association doit, par ailleurs, remplir certaines conditions. Ainsi, ses statuts et ses modalités de fonctionnement doivent assurer sa transparence financière, l’élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants. De plus, le versement d’une rémunération doit être explicitement prévu dans les statuts et son organe délibérant doit avoir décidé son montant et ses conditions à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une tolérance administrative pour toutes
Toutes les associations, quel que soit le montant de leurs ressources, peuvent rémunérer un ou plusieurs dirigeants sans perdre le caractère désintéressé de leur gestion si la rémunération mensuelle brute de chacun d’entre eux n’excède pas les trois quarts du Smic, soit, en 2017, 1 110,20 €.
Et attention, car l’administration fiscale assimile à des dirigeants les personnes qui, sans être investies statutairement, exercent néanmoins un contrôle effectif et constant de l’association et en définissent les orientations (appelées « dirigeants de fait »).
Attention : les grandes associations qui rémunèrent certains de leurs dirigeants en application de l’exception légale ne peuvent pas appliquer aussi la tolérance administrative et donc verser à d’autres dirigeants une rémunération limitée aux trois quarts du Smic.
© Les Echos Publishing 2017