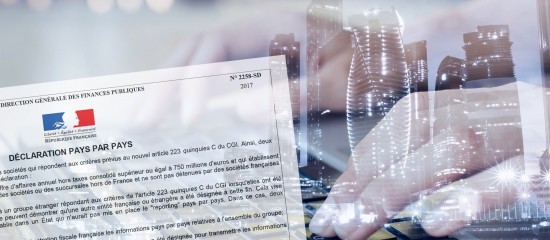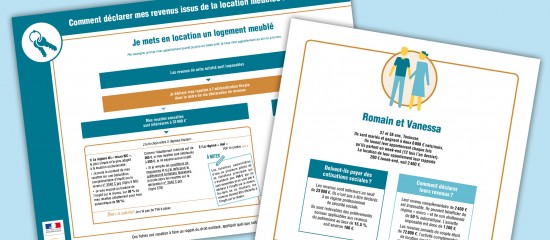La loi de finances rectificative pour 2016 a étendu le champ d’application de la déduction exceptionnelle (ou suramortissement) applicable aux investissements productifs, éligibles en principe à l’amortissement dégressif.
Rappel : ce dispositif permet une déduction exceptionnelle de 40 % du prix du bien éligible, étalée de façon linéaire sur la durée d’utilisation normale du bien.
Ainsi, alors que ce dispositif devait s’achever pour les biens acquis ou fabriqués au-delà du 14 avril 2017, le législateur l’a maintenu aux biens éligibles acquis après cette date, dès lors qu’ils font l’objet de commandes réalisées avant le 15 avril 2017.
Ces commandes doivent néanmoins être assorties du versement d’acomptes d’au moins 10 % du montant total de la commande. Par ailleurs, l’acquisition définitive des biens concernés doit intervenir dans les 2 ans à compter de la date de la commande.
L’administration fiscale vient, dans le cadre des commentaires administratifs de cette mesure, de préciser le champ d’application de l’extension du suramortissement.
Ainsi, la date à retenir pour apprécier si un bien ouvre droit à la déduction exceptionnelle doit être distinguée selon trois situations :
– lorsque l’acompte est versé en même temps que la commande, la date à retenir est celle à laquelle le bon de commande ou tout autre document en tenant lieu est reçu par le fournisseur ;
– lorsque l’acompte intervient après la commande, la date à retenir est celle à laquelle les sommes sont portées au débit du compte bancaire du cat ou, le cas échéant, celle à laquelle l’organisme de financement procède au paiement ;
– lorsque le paiement fait l’objet de plusieurs acomptes, c’est la date du versement permettant d’atteindre le seuil de 10 % qui doit être prise en compte.
Précision : la déduction exceptionnelle s’applique néanmoins toujours à compter du 1er jour du mois de l’acquisition définitive du bien.
S’agissant des biens fabriqués, l’administration n’étend pas le bénéfice du suramortissement aux biens fabriqués par l’entreprise elle-même et qui seraient achevés après le 14 avril 2017.
Toutefois, elle permet l’application du suramortissement aux biens fabriqués à compter du 15 avril 2017 pour le compte d’une entreprise par des sous-traitants ou des façonniers et destinés à être incorporés dans un ensemble dès lors qu’ils remplissent les conditions susvisés (date de la commande, versement d’acomptes de 10 %, acquisition dans les 2 ans de la commande).
Enfin, dans le cas où les biens incorporés dans un ensemble ne font pas l’objet d’une commande unique mais de plusieurs commandes distinctes, l’éligibilité desdits biens à la déduction exceptionnelle s’apprécie, selon l’administration, commande par commande.
S’agissant du formalisme relatif à l’extension du suramortissement, les entreprises devront, sur demande de l’administration, fournir une copie de la commande et de son accusé de réception indiquant le prix du bien commandé ainsi que, le cas échéant, le montant de l’acompte versé et, éventuellement, une attestation des versements complémentaires d’acomptes.
À savoir : l’administration précise également dans ses commentaires la date de début d’application de l’extension du suramortissement des poids-lourds peu polluants aux utilitaires légers et aux véhicules fonctionnant exclusivement au carburant ED95. Elle indique que cette extension peut bénéficier aux véhicules acquis dès le 1er janvier 2016. Toutefois, s’agissant des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, lorsque l’acquisition a eu lieu au cours d’un exercice clos avant le 31 décembre 2016, la déduction exceptionnelle est pratiquée à compter de l’exercice suivant.
BOI-BIC-BASE-100 du 1er février 2017