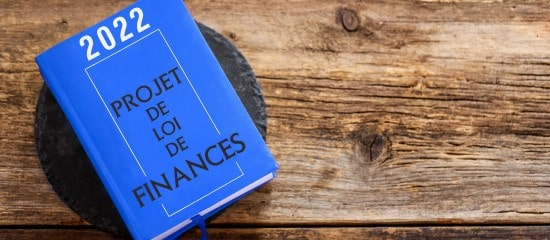Le projet de loi de finances pour 2022 a été dévoilé. Du côté des entreprises, il acte principalement les mesures fiscales annoncées par le président de la République dans le cadre du plan « indépendants » visant à faciliter la transmission des entreprises grâce, notamment, à un aménagement de certains dispositifs d’exonération des plus-values.
Départ à la retraite
Un exploitant individuel peut bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre des plus-values professionnelles réalisées lors de la vente de son entreprise au moment de son départ en retraite. Un régime de faveur qui nécessite, notamment, que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise cédée et qu’il fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession.
Le projet de loi propose de porter ce délai à 3 ans lorsque l’entrepreneur fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession. Cette mesure s’adresse en particulier aux entrepreneurs qui, ayant atteint l’âge de la retraite pendant la crise sanitaire, ont rencontré des difficultés pour trouver un repreneur dans le délai imparti.
Une modification qui s’appliquerait également dans le cadre de l’abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values de cession réalisées par le dirigeant qui cède les titres de sa PME soumise l’impôt sur les sociétés pour partir à la retraite. Le délai entre le départ à la retraite et la cession serait donc porté de 24 à 36 mois pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
Précision : en outre, cet abattement, qui devait prendre fin au 31 décembre 2022, serait prolongé jusqu’en 2024.
Transmission d’une PME
Les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission d’une PME ou d’une branche complète d’activité peuvent, sous certaines conditions, être exonérées en totalité si la valeur de l’entreprise transmise est inférieure à 300 000 € ou partiellement lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.
Le projet de loi de finances envisage d’augmenter ces plafonds afin d’être en concordance avec les réalités économiques et la valorisation des entreprises. Ainsi, la valeur des éléments transmis devrait être inférieure à 500 000 € pour une exonération totale et comprise entre 500 000 € et 1 000 000 € pour une exonération partielle.
Le cas de la location-gérance
Les plus-values issues de la cession d’un fonds donné en location-gérance peuvent bénéficier des exonérations précitées pour départ en retraite ou pour transmission d’une PME. À ce titre, la cession doit, entre autres, être effectuée au profit du locataire-gérant en place.
Le projet de loi autoriserait cette cession à un tiers, c’est-à-dire à toute personne autre que le locataire-gérant, dès lors que la cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité objet du contrat de location-gérance. Cet élargissement permettrait ainsi de ne plus bloquer les reprises d’entreprises en cas de fragilité financière du locataire-gérant.
La formation
Afin de faciliter l’accès à la formation des chefs d’entreprise, le montant du crédit d’impôt dédié à la formation serait doublé pour les TPE (moins de 10 salariés, CA annuel ou total de bilan < 2 M€).
À noter : actuellement, le montant du crédit d’impôt est égal au maximum à 410 €.
Art. 5, projet de loi de finances pour 2022, n° 4482, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 22 septembre 2021