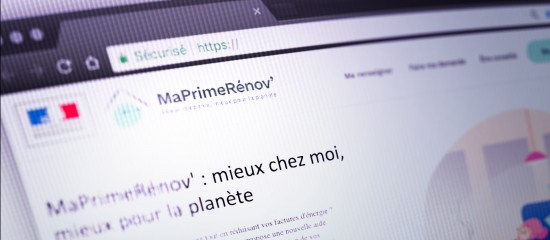Les entreprises en difficulté en raison de l’épidémie de coronavirus peuvent obtenir des délais de paiement ou des remises d’impôts.
Le nombre de cas confirmés de personnes infectées par le coronavirus (Covid-19) ne cesse de croître sur le territoire national. De telle sorte que de nombreux salariés se retrouvent confinés à leur domicile. Et que beaucoup d’entreprises subissent une baisse d’activité, en particulier dans certains secteurs. Récemment, de nouvelles mesures ont été prises en matière fiscale pour aider les entreprises en difficulté.
Le gouvernement avait déjà annoncé, il y a quelques temps, la possibilité pour les entreprises qui en éprouvaient le besoin de demander un report de leurs échéances fiscales. Dernièrement, il a précisé la marche à suivre pour demander des délais de paiement ou des remises d’impôts directs (impôt sur les bénéfices, cotisation foncière des entreprises…).
Dans un premier temps, l’administration fiscale a mis à disposition des professionnels un modèle spécifique de demande à adresser à leur service des impôts des entreprises, accessible sur le site www.impots.gouv.fr. Plusieurs éléments justificatifs devant être renseignés (baisse du chiffre d’affaires, situation de la trésorerie…).
Mais lors de son allocution télévisée du 12 mars dernier, le Président de la République est allé plus loin en annonçant que les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justifications, sans formalités et sans pénalités le paiement des impôts dus en mars. Un simple mail à l’administration fiscale devrait donc suffire. Quant aux échéances des prochaines semaines, elles pourront, selon le chef de l’État, être suspendues.
À noter : des mesures d’annulation et de rééchelonnement devraient également être prises. Reste à savoir dans quelles conditions… En principe, les remises d’impôts directs sont réservées aux situations les plus difficiles et sont décidées dans le cadre d’un examen individualisé des demandes.
Si les entreprises ont déjà réglé leurs échéances de mars, elles peuvent soit s’opposer au prélèvement SEPA auprès de leur banque en ligne, soit en demander le remboursement auprès de leur service des impôts, une fois le prélèvement effectif.
Du côté des travailleurs indépendants, le taux et les acomptes de prélèvement à la source peuvent être modulés à tout moment. Sans oublier qu’ils peuvent reporter le paiement de leurs acomptes d’un mois sur l’autre. Une faculté de report qui peut concerner trois échéances par an en cas de paiement mensuel ou une seule en cas de paiement trimestriel. Ces démarches sont accessibles dans leur espace particulier sur www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Sachant que toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant.
Enfin, pour les contrats de mensualisation de la CFE ou de la taxe foncière, le paiement peut être suspendu sur www.impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement service. Le montant restant dû sera prélevé au moment du solde, sans pénalité.
À noter : pour toute difficulté dans le paiement des impôts, les entreprises ne doivent pas hésiter à contacter leur service des impôts par la messagerie sécurisée de leur espace professionnel, par courriel ou par téléphone.
© Les Echos Publishing 2020