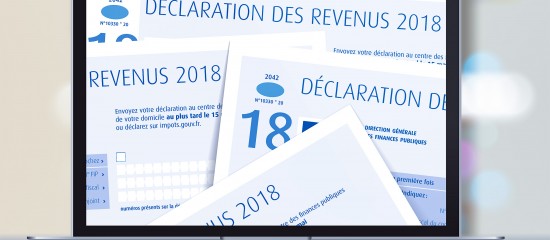Utiliser un véhicule de l’entreprise ou son propre véhicule pour ses déplacements professionnels n’entraîne pas les mêmes conséquences fiscales.
Les frais d’achat et de fonctionnement
Lorsqu’un dirigeant choisit de faire acheter ou de faire louer une voiture par son entreprise, cette dernière en supporte directement les frais d’acquisition et de fonctionnement. Fiscalement, elle peut, dans certaines limites, déduire l’amortissement ou les loyers de la voiture. Ainsi, pour les voitures acquises ou louées en 2019, la déduction de l’amortissement ou du loyer, calculée sur une base TTC, est plafonnée à 30 000 €, à 20 300 €, à 18 300 € ou à 9 900 € selon le taux d’émission de CO2 en g/km. Ne sont toutefois pas concernées par cette limitation les voitures nécessaires à l’entreprise en raison de l’objet même de son activité (taxis, ambulances…), ni celles prises en location pour une courte durée (< 3 mois, non renouvelable).
À noter : la durée d’amortissement d’une voiture est généralement de 4 à 5 ans selon les usages ou ses conditions d’utilisation.
Quant aux frais de fonctionnement de la voiture (entretien, carburant, réparations…), ils sont déductibles du résultat sans limitation.
En revanche, s’agissant de la TVA, l’entreprise ne peut pas récupérer la TVA grevant le prix d’achat ou le loyer de la voiture, sauf exceptions (taxis, véhicules sanitaires légers, auto-écoles…), ni celle supportée sur les frais d’entretien et de réparation. La TVA sur le gazole et le superéthanol E85 est, quant à elle, déductible à hauteur de 80 %. S’agissant de l’essence, en 2019, la taxe n’est récupérable qu’à hauteur de 40 %. Enfin, la TVA est déductible à hauteur de 100 % pour le GPL (gaz de pétrole liquéfié), le GNV (gaz naturel pour véhicule) et l’électricité.
Particularité : les entreprises doivent normalement joindre à leur déclaration de résultats un état indiquant l’affectation des voitures inscrites à l’actif ou celles dont elles prennent en charge les frais d’entretien.
L’évaluation des frais
Les entreprises doivent, en principe, prendre en compte les dépenses engendrées par leurs voitures pour leur montant réel. Mais à titre d’exception, les professionnels libéraux, titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), peuvent opter pour une évaluation forfaitaire, à l’aide du barème kilométrique publié chaque année par l’administration fiscale, à condition de ne pas déduire en charges les dépenses ou les loyers correspondants. Cette option est annuelle et doit être exercée pour toutes les voitures utilisées à titre professionnel.
Concrètement, recourir à ce barème kilométrique permet d’évaluer plus simplement un ensemble de frais (dépréciation du véhicule, pneumatiques, frais courants de réparation et d’entretien, carburant, primes d’assurance), évitant ainsi au professionnel de les répertorier individuellement. Le barème prenant en compte la distance parcourue à titre professionnel et la puissance fiscale du véhicule, dans la limite de 7 CV pour les voitures.
La taxe sur les véhicules de sociétés
Chaque année, les entreprises exploitées sous forme de sociétés sont redevables de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) pour les voitures qu’elles utilisent. Les exploitants individuels ne sont donc pas redevables de cette taxe. Une TVS qui n’est pas déductible lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.
Le montant de la TVS est égal à la somme de deux composantes. La première est fonction soit du taux d’émission de CO2 du véhicule, soit de sa puissance fiscale, tandis que la seconde est fonction du type de carburant utilisé par le véhicule et de l’année de sa première mise en circulation. Certains véhicules sont toutefois exonérés, en tout ou partie, de TVS, en particulier les voitures non polluantes.
Le bonus/malus
Le malus écologique est une taxe anti-pollution appliquée lors de la première immatriculation d’une voiture. Il est calculé à partir d’un niveau d’émission de CO2 supérieur ou égal à 117 g/km pour 2019.
En revanche, lors de l’achat ou de la location (avec option d’achat ou pour une durée d’au moins 2 ans) d’une voiture électrique neuve, un bonus écologique peut être versé. Son montant est égal à 27 % du coût d’acquisition TTC du véhicule, dans la limite de 6 000 €.
L’utilisation personnelle d’un véhicule de l’entreprise
Si le dirigeant utilise une voiture de l’entreprise à des fins personnelles, il s’agit d’un véhicule à usage mixte. L’exploitant individuel doit alors réintégrer au bénéfice imposable la fraction des charges (amortissement, entretien…) correspondant à cette utilisation privative.
Pour un dirigeant de société, l’utilisation à titre personnel d’une voiture de l’entreprise (on parle de « véhicule de fonction ») constitue un avantage en nature soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Cet avantage en nature étant déductible par l’entreprise. Il est évalué pour son montant réel ou, sur option, sur une base forfaitaire (sauf pour les gérants majoritaires de SARL). En pratique, l’entreprise doit faire figurer cet avantage en nature sur un état spécial, en annexe de la comptabilité et, le cas échéant, sur le relevé de frais généraux.
Précision : sont visées les voitures de tourisme, c’est-à-dire les véhicules automobiles immatriculés dans la catégorie des « voitures particulières » (berlines, breaks, cabriolets…), y compris les véhicules « à usages multiples » lorsqu’ils sont destinés au transport de voyageurs. Sont également concernés, depuis le 1
Lorsqu’un entrepreneur individuel utilise sa propre voiture, non inscrite à l’actif, pour effectuer des déplacements professionnels, il peut déduire la quote-part de frais relatifs à cette utilisation professionnelle, à l’exception des charges de propriété (amortissement…).
Le dirigeant de société bénéficie, quant à lui, d’un remboursement de frais par l’entreprise. Ce remboursement peut être calculé sur la base des barèmes fiscaux. Il est alors exonéré d’impôt sur le revenu et de charges sociales. Pour la société versante, ces remboursements sont logiquement déductibles. Mais attention à un point important : la TVS s’applique au véhicule personnel du dirigeant lorsque le remboursement de ses frais kilométriques représente plus de 15 000 kilomètres sur l’année. Toutefois, la taxe n’est due qu’à hauteur de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % de son montant selon que le nombre de kilomètres remboursés est compris respectivement entre 15 001 et 25 000, entre 25 001 et 35 000, entre 35 001 et 45 000 ou excède 45 000. Le montant à verser faisant l’objet, en outre, d’un abattement de 15 000 €.
À noter : les véhicules utilitaires présentent une fiscalité plus avantageuse que les voitures (pas de limitation de déduction de l’amortissement ou du loyer, TVA déductible sur l’achat, la location, les frais d’entretien et de réparation, pas de TVS…). Cependant, en pratique, ils n’offrent pas la possibilité d’une utilisation mixte.
En conclusion
Le régime fiscal qui découle de l’utilisation d’un véhicule de l’entreprise ou d’un véhicule personnel n’est pas le seul élément à prendre en compte pour choisir entre l’achat d’un véhicule à titre personnel ou au nom de l’entreprise. D’autres facteurs doivent entrer en ligne de compte, tels que l’importance du kilométrage parcouru ou le montant de votre trésorerie. En effet, utiliser son véhicule personnel permet de limiter les dépenses supportées par l’entreprise, une solution qui peut être à privilégier en début d’activité. L’idéal est donc de réaliser des simulations chiffrées afin de comparer chaque option et choisir la mieux adaptée à votre situation.
© Les Echos Publishing 2019