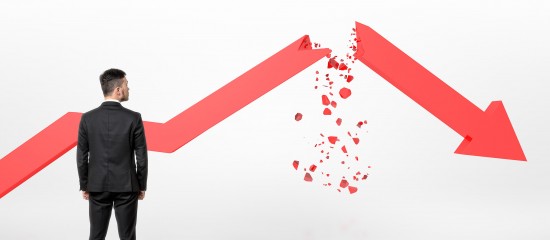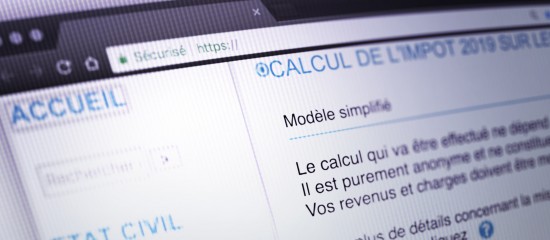Les entreprises, qu’elles relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui consentent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt significative sur les bénéfices.
À savoir : outre le mécénat, une entreprise peut également pratiquer le parrainage (ou sponsoring). Mais attention, alors que le don se réalise sans contrepartie ou avec une contrepartie limitée, le parrainage est une opération commerciale dont l’entreprise retire un bénéfice direct et proportionné au soutien qu’elle apporte. En d’autres termes, elle achète un service publicitaire. Contrairement aux dons, qui ouvrent droit à une réduction d’impôt, les dépenses de sponsoring sont, sous conditions, déductibles du résultat imposable de l’entreprise.
Les organismes bénéficiaires
Pour que leurs dons ouvrent droit à l’avantage fiscal, les entreprises doivent en faire profiter une des catégories d’organismes limitativement énumérés par la loi. Parmi ceux-ci, on trouve notamment les œuvres ou organismes d’intérêt général :– ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ;– ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
À noter : sont, en revanche, exclus les dons aux associations exerçant des actions en faveur du pluralisme de la presse.
La forme du don
Les dons en numéraire (versement d’une somme d’argent) sont bien évidemment éligibles à la réduction d’impôt, mais, c’est moins connu, les dons en nature (don ou prêt d’un bien, réalisation d’une prestation) ou en compétences (mise à disposition d’un salarié) le sont également.
Le montant de la réduction d’impôt
L’avantage fiscal est égal à 60 % du montant des versements ou de la valeur du don, retenu dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise. Un plafond alternatif de 10 000 € s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
Précision : lorsque le plafond est dépassé, l’excédent de versement peut ouvrir droit à la réduction d’impôt au titre des 5 exercices suivants, après prise en compte des versements de l’exercice, et dans la limite du plafond précité.
La réduction d’impôt s’impute :– sur l’impôt dû au titre de l’année de réalisation des dons, quelle que soit la date de clôture de l’exercice, lorsqu’il s’agit d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ;– sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements ont été effectués lorsqu’il s’agit d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés.
Précision : si la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent peut être utilisé pour le paiement de l’impôt relatif aux 5 années ou exercices suivants.
Une nouvelle déclaration
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les entreprises qui consentent, au cours d’un exercice, plus de 10 000 € de dons éligibles à la réduction d’impôt mécénat doivent les déclarer, par voie électronique, auprès de l’administration fiscale, dans le même délai que la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons ont été réalisés. Concrètement, l’entreprise doit transmettre, selon des modalités qui restent à préciser par décret, le montant et la date des dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie.
Rappel : les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel doivent télétransmettre, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, leur déclaration de résultats au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Il en va de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne clôturent pas leur exercice au 31 décembre doivent déposer leur déclaration de résultats dans les 3 mois suivant cette clôture. Dans tous les cas, les entreprises bénéficient d’un délai supplémentaire de 15 jours.