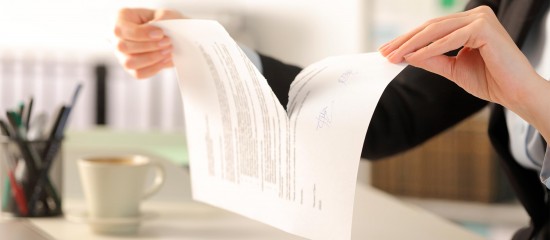Un « droit à l’essai » a été récemment instauré pour permettre à une personne de tester un projet d’exercice en commun d’une activité agricole. Pour formaliser une telle association, une convention doit être conclue. Un modèle de convention-type est désormais disponible.
On se souvient que la loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 avait notamment pour objectif d’encourager le renouvellement des générations en agriculture et donc de favoriser l’installation de nouveaux exploitants.
Parmi les mesures prévues à cette fin, la loi a instauré un dispositif original de « droit à l’essai » afin de permettre à une personne qui souhaite tester un projet d’exercice en commun d’une activité agricole dans une exploitation ou dans une société avec un ou plusieurs autres exploitants. Formalisé par un contrat, cet essai a vocation à durer pendant un an, renouvelable une fois, avec une possibilité de résiliation à tout moment par les intéressés.
Un modèle de convention
À ce titre, les pouvoirs publics viennent de mettre à disposition des intéressés un modèle de convention-type. Conclue à titre gratuit entre la personne à l’essai et l’exploitation qui l’accueille, cette convention doit préciser les conditions dans lesquelles l’essai d’association se réalise. Elle doit notamment indiquer la nature du div contractuel entre les parties, à savoir soit un contrat de travail, soit un contrat d’apprentissage, soit un contrat de stage, soit un contrat d’entraide familiale, soit enfin un statut d’aide familial pour la personne à l’essai.
Elle doit également mentionner les modalités selon lesquelles la personne à l’essai est associée à la vie de l’exploitation (participation effective aux travaux, participation à la prise de décisions, accès aux documents comptables, financiers, techniques, contractuels…).
Ce modèle de convention figure en annexe d’un
.
© Les Echos Publishing 2026