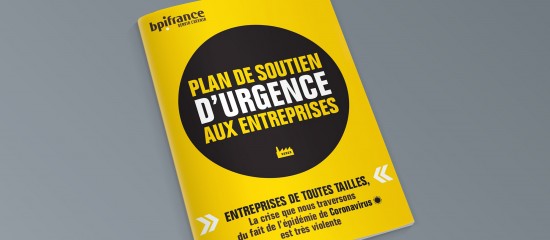Les dettes d’une association peuvent être mises à la charge de leurs dirigeants lorsque leurs fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif.
Les dirigeants d’une association mise en liquidation judiciaire peuvent être tenus de combler l’insuffisance d’actif s’ils ont commis une faute de gestion y ayant contribué.
Dans une affaire récente, une association qui réhabilitait des logements et les donnait à bail avait été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur soutenait que le montant de l’insuffisance d’actif devait être supporté par les trois dirigeants de la structure compte tenu de leurs fautes de gestion. Une demande rejetée par la cour d’appel au motif que si ces derniers avaient effectivement commis de telles fautes, celles-ci n’avaient pas contribué à l’insuffisance d’actif de l’association.
Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation. Elle a estimé que si l’insuffisance d’actif de l’association était la conséquence d’un emprunt, les difficultés liées à son remboursement étaient dues à des problèmes de location et de loyers impayés des logements réhabilités. Et, pour les juges, la décision de contracter un emprunt ne constituait pas une faute de gestion. Les dettes de l’association n’avaient donc pas à être supportées par les dirigeants de l’association.
© Les Echos Publishing 2020