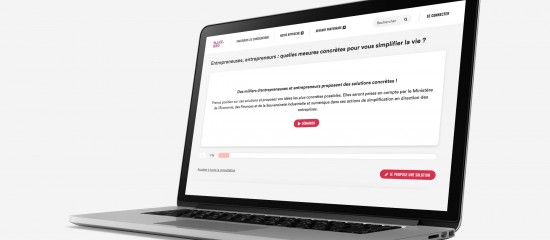L’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure permet au gouvernement de dissoudre, par décret, une association ou un groupement de fait qui provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée à une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou qui propage des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence.
En outre, depuis 2021, le gouvernement est également autorisé à dissoudre une association ou un groupement de fait qui provoque à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens.
Entre 2021 et 2023, le gouvernement a ainsi dissous une association, Coordination contre le racisme et l’islamophobie, ainsi que trois groupements de fait, l’Alvarium, Les Soulèvements de la Terre et le Groupe Antifasciste Lyon et environs. Des décrets dont ces organisations ont demandé l’annulation en justice.
Des principes
Dans quatre décisions récentes, le Conseil d’État a estimé que, conformément à l’article 212-1 du Code de la sécurité intérieure, le gouvernement peut dissoudre une organisation lorsque celle-ci :– incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l’ordre public ;– légitime publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu’en soit les auteurs, ou ne met pas en œuvre des moyens de modération pour réagir à la diffusion, sur des services de communication au public en ligne (réseaux sociaux, notamment), d’incitations explicites à commettre des actes de violence.
Mais attention, la dissolution ne peut être prononcée que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par ces agissements.
L’annulation de la dissolution du groupement Les Soulèvements de la Terre
Les Soulèvements de la Terre organise des actions militantes visant à alimenter le débat public sur, notamment, la préservation de l’environnement et la lutte contre la consommation excessive des ressources naturelles.
Le gouvernement lui reprochait notamment de légitimer des actions violentes dans le cadre de la contestation de certains projets d’aménagement (notamment, la construction de retenues de substitution à Sainte-Soline) et d’inciter à la commission de dégradations matérielles, ces provocations ayant été suivies d’effet à plusieurs reprises.
Pour le Conseil d’État, ce groupement n’a pas commis de provocations explicites à la violence contre les personnes. En effet, le fait de relayer, à plusieurs reprises et « avec une certaine complaisance », des images ou des vidéos d’affrontements de manifestants avec les forces de l’ordre ne permet pas de dire que le groupement a revendiqué, valorisé ou justifié publiquement des agissements. De plus, le fait que des membres des forces de l’ordre aient été blessés lors de heurts avec des manifestants, dont certains se seraient réclamé des Soulèvements de la Terre, ne constitue pas une provocation imputable à ce dernier.
En revanche, les juges ont considéré qu’il pouvait être reproché au groupement une provocation à des agissements violents contre les biens. En effet, ses prises de position publiques, qui s’inscrivent dans le cadre d’une mouvance écologiste radicale, appellent à la destruction ou à la dégradation des infrastructures portant atteinte à l’environnement et compromettant l’égal accès aux ressources naturelles (méga-bassines, sites industriels jugés polluants, plantations qualifiées d’intensives, engins de chantier…). Des appels qui ont parfois conduit à des dégradations que le groupement a légitimées publiquement, à plusieurs reprises, sur les réseaux sociaux. Pour les juges, le fait que, selon ce groupement, ces prises de position participeraient d’un débat d’intérêt général sur la préservation de l’environnement et auraient une portée symbolique n’enlève pas leur qualification de provocation à des agissements violents contre les biens.
Malgré cela, le Conseil d’État a estimé que la portée des provocations, explicites ou implicites, à la violence contre les biens, mesurée notamment par les effets réels qu’elles ont pu avoir, ne justifiait pas la dissolution du groupement. En effet, cette mesure n’était pas adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public. Les juges ont donc annulé la dissolution des Soulèvements de la Terre.
La dissolution des trois autres organisations
En revanche, le Conseil d’État a confirmé les dissolutions de Coordination contre le racisme et l’islamophobie, de l’Alvarium et du Groupe Antifasciste Lyon et environs. Pour ces juges, celles-ci n’étaient, en effet, pas disproportionnées compte tenu de la teneur, de la gravité et de la récurrence de leurs agissements.
Le Conseil d’État a considéré que les agissements de l’association Coordination contre le racisme et l’islamophobie étaient de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers des personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou les encourager. L’association avait, notamment, publié, à de nombreuses reprises, sur ses comptes sur les réseaux sociaux, des propos « tendant, y compris explicitement, à imposer l’idée que les pouvoirs publics, la législation, les différentes institutions et autorités nationales ainsi que de nombreux partis politiques et médias seraient systématiquement hostiles aux croyants de religion musulmane et instrumentaliseraient l’antisémitisme pour nuire aux musulmans ». Des publications qui avaient généré, sur ces comptes, de nombreux commentaires haineux, antisémites, injurieux appelant à la vindicte publique et que l’association n’avait ni contredits ni effacés.
Par ailleurs, il était reproché au groupement de fait l’Alvarium d’avoir justifié ou encouragé la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d’origine non-européenne, en particulier celles de confession musulmane, en diffusant sur les réseaux sociaux des messages « propageant des idées justifiant la discrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l’immigration par leur assimilation à des délinquants ou des criminels, à des islamistes ou des terroristes » et en entretenant des divs avec des groupuscules appelant à la discrimination, à la violence ou à la haine contre les étrangers.
Enfin, le Conseil d’État a estimé que le Groupe Antifasciste Lyon et environs avait provoqué à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens. Il lui était, en effet, reproché d’avoir « publié sur les réseaux sociaux, de façon répétée et pendant plusieurs années, des messages dans lesquels étaient insérés des photographies ou dessins représentant des policiers ou des véhicules de police incendiés, recevant des projectiles ou faisant l’objet d’autres agressions ou dégradations, en particulier lors de manifestations, assortis de textes haineux et injurieux à l’encontre de la police nationale, justifiant l’usage de la violence envers les représentants des forces de l’ordre, leurs locaux et leurs véhicules, se réjouissant de telles exactions, voire félicitant leurs auteurs » et d’avoir « diffusé des messages approuvant et justifiant, au nom de l’antifascisme, des violences graves commises à l’encontre de militants d’extrême-droite et de leurs biens » ainsi que de ne pas avoir supprimé, sur ses réseaux sociaux les appels de tiers appelant à la violence, voire au meurtre, contre des internautes se réclamant de l’ultra-droite.
Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 464412
Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 476384
Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 459704
Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 460457