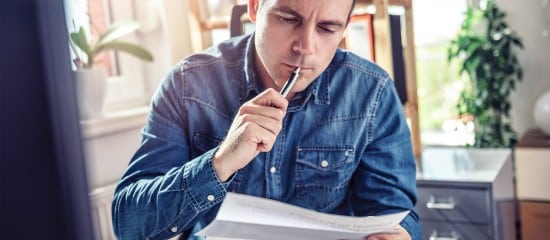Les commerces qui ont été ou qui sont encore contraints de rester fermés en raison de la crise sanitaire sont à l’abri d’éventuelles sanctions de leur bailleur lorsqu’ils ne paient pas leur loyer pendant cette période de crise. Par ailleurs, ils peuvent demander un report du paiement de leurs factures d’eau et d’énergie. Prises en mars dernier lors du premier confinement, ces mesures sont reconduites au titre du deuxième. Explications.
Les loyers et charges locatives
Comme au printemps dernier, les pouvoirs publics sont venus protéger les entreprises dont l’activité est « affectée par une mesure de police administrative » prise dans le cadre du 2e confinement et qui ne peuvent pas payer leur loyer. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été (librairies, parfumeries…) ou qui sont encore dans l’obligation de rester fermés (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport…).
Ainsi, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges locatives pendant une certaine période (v. ci-dessous), leur bailleur est soumis à l’interdiction de leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts. Il ne peut pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.
De même, les procédures qui auraient été engagées, pendant cette période protégée, par un bailleur contre son locataire pour cause de non-paiement du loyer sont suspendues.
L’objet de cette mesure est donc de permettre à ces entreprises très en difficulté de cesser temporairement de régler leur loyer sans qu’une sanction puisse leur être infligée. Et donc d’obliger en quelque sorte leur bailleur à leur accorder un report.
Attention : un décret, pas encore paru à l’heure où nous écrivons ces lignes, doit encore préciser les entreprises qui peuvent bénéficier de cette protection en termes, notamment, de seuil d’effectif, de chiffre d’affaires et de perte de chiffre d’affaires subie en raison de la fermeture. À ce titre, on peut penser, mais le décret devra le confirmer, que la mesure de protection relative au paiement du loyer s’applique non seulement aux commerces qui ont été ou qui restent fermés, mais aussi à ceux qui ont dû cesser de vendre des produits non essentiels ou restreindre leur capacité d’accueil.
Une certitude : cette mesure s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de la réouverture du commerce (plus précisément, à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cessera d’être affectée par la mesure administrative).
Attention : des intérêts ou des pénalités financières pourront, le cas échéant, être dus par l’entreprise locataire si elle ne paie pas son loyer à compter de l’expiration de la période indiquée ci-dessus. Ils seront alors calculés à compter de l’expiration de ladite période.
Les factures d’eau et d’énergie
Dès lors qu’ils satisferont aux conditions définies par le décret à paraître, ces mêmes commerces auront la possibilité de demander à leur fournisseur d’eau, de gaz et d’électricité un report du paiement de leurs factures, reçues pour leurs locaux commerciaux, exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date de leur réouverture. Le fournisseur sera tenu de leur accorder ce report, sans pénalités financières, frais ou indemnités. Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale, et sur une durée d’au moins 6 mois, sur les échéances de paiement des factures postérieures.
En outre, les fournisseurs ont l’interdiction d’interrompre, de suspendre ou de réduire la distribution d’eau ou d’énergie, ainsi que de résilier le contrat, aux commerces affectés par une mesure de police administrative au motif qu’ils n’auraient pas payé leurs factures exigibles pendant la période protégée. Les fournisseurs d’électricité ne peuvent pas non plus réduire la puissance d’électricité distribuée à ces commerces.
Art. 14, loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, JO du 15