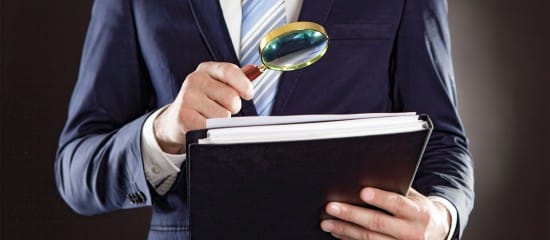Pour les souscriptions au capital de PME ou de parts de FCPI ou de FIP, le taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt s’applique depuis le 10 août 2020.
Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils souscrivent au capital d’une PME ou acquièrent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Cette réduction d’impôt, dite « Madelin », vient de connaître des aménagements concernant les taux de réduction à appliquer. Des changements qui interviennent après que la Commission européenne a déclaré conforme le dispositif à la règlementation européenne sur les aides d’État.
Ainsi, tout d’abord, le taux majoré de 18 à 25 %, mis en place pour compenser partiellement la suppression du dispositif ISF-PME, trouve désormais à s’appliquer pour les investissements réalisés à compter du 10 août et jusqu’au 31 décembre 2020.
Ensuite, pour les fonds communs de placement dans l’innovation ou les fonds d’investissement de proximité, les versements effectués à compter du 10 août 2020 ne sont retenus qu’à proportion du quota d’investissement que le fonds s’engage à atteindre. Rappelons que ces fonds doivent a minima respecter un quota d’investissement de 70 % dans des sociétés éligibles à la réduction d’impôt.
Enfin, le taux dérogatoire de la réduction FIP Corse et FIP outre-mer est abaissé de 38 à 30 % pour les versements effectués, là encore, à compter du 10 août 2020.
© Les Echos Publishing 2020