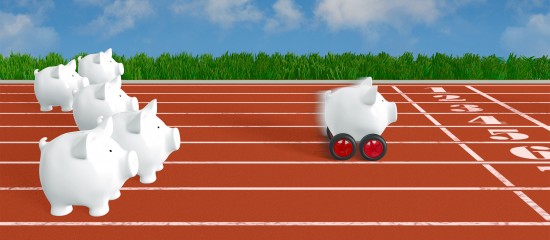La fiscalité de l’épargne est modifiée en profondeur par l’instauration d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU). Encore appelé « flat tax », le PFU se compose d’une taxation forfaitaire à l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et de prélèvements sociaux au taux cumulé de 17,2 %, soit une imposition globale de 30 %. À noter que cette réforme semble favorable aux épargnants fortement fiscalisés.
Champ d’application
À compter du 1er janvier 2018, le prélèvement forfaitaire unique s’applique aux revenus mobiliers et aux plus-values de cession de titres.
Pour la première catégorie, le champ d’application est vaste puisque le PFU concerne notamment les dividendes, les produits de placement à revenu fixe, autrement dit les intérêts (obligations, bons de caisse, créances, cautionnement, comptes courants, titres de créances négociables…), les jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance de société anonyme, les produits répartis par les fonds communs de placement et les revenus d’actifs mobiliers des fonds de placement immobilier, ainsi que les produits résultant de la première cession d’usufruit temporaire.
Pour la seconde catégorie, sont notamment visées, outre les plus-values de cession de titres, les distributions de plus-values par certains organismes de placement collectif, les distributions de plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par les fonds de placement immobilier, les distributions de plus-values aux actionnaires de sociétés de capital-risque, les plus-values réalisées à titre occasionnel sur des instruments financiers à terme et les plus-values et créances soumises à l’exit tax.
Modalités d’imposition
Revenus mobiliers
L’assiette du PFU est constituée par le montant brut des revenus mobiliers. Ce montant brut pouvant être diminué de l’abattement spécifique aux contrats d’assurance-vie, des pertes sur titres ou contrats de créances négociables et des pertes en capital subies suite à un non-remboursement d’un prêt ou d’un minibon.
En pratique, l’imposition est toujours effectuée en deux temps. D’abord, l’année de leur versement, les revenus mobiliers font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 %. Ensuite, l’année suivante, l’imposition définitive intervient après la traditionnelle déclaration des revenus. L’impôt dû par le redevable sur ces revenus est alors imputé du prélèvement forfaitaire non libératoire déjà versé. En d’autres termes, le prélèvement forfaitaire non libératoire, dont le taux est identique au PFU, revient à une sorte de « prélèvement à la source ».
Plus-values de cession de titres
Le PFU est assis sur le montant des plus-values après imputation des pertes. Les moins-values constatées une année devant être imputées prioritairement sur les plus-values de même nature générées la même année. En cas de solde positif, les plus-values sont ensuite réduites des éventuelles moins-values constatées au cours des 10 années antérieures. À l’inverse, en cas de solde négatif, les moins-values constatées sont imputables sur les plus-values des 10 années suivantes.
Précision : le système des abattements proportionnels pour durée de détention n’est plus applicable. En revanche, est maintenu l’abattement fixe de 500 000 € pour les plus-values de cession de titres réalisées par un dirigeant partant à la retraite. La cession devant toutefois intervenir entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022.
Des règles spécifiques pour l’assurance-vie
L’assurance-vie est également concernée par la flat tax. Cette dernière vise, lors d’un rachat partiel ou total effectué par l’assuré, les produits perçus à compter de 2018 correspondants à des versements réalisés à compter du 27 septembre 2017. La taxation, au titre de l’impôt sur le revenu, est alors égale à :– 12,8 % lorsque le contrat a une durée inférieure à 8 ans ;– 7,5 % lorsque le contrat a une durée supérieure à 8 ans et que les primes versées sur l’ensemble des contrats d’assurance-vie de l’assuré ne dépassent pas 150 000 € ;– 12,8 % lorsque le contrat a une durée supérieure à 8 ans et que les primes versées sur l’ensemble des contrats d’assurance-vie de l’assuré dépassent 150 000 €. Étant précisé que l’assuré bénéficie toutefois du taux réduit de 7,5 % sur les produits attachés aux primes constituant la fraction allant jusqu’à 150 000 €.
Pour les produits attachés à des versements réalisés avant le 27 septembre 2017, c’est l’ancienne fiscalité qui continue à s’appliquer.
À cette taxation forfaitaire s’ajoute également les prélèvements sociaux.
Comme pour les revenus mobiliers, l’imposition s’effectue en deux temps, avec un prélèvement forfaitaire non libératoire lors du versement des produits et une imposition définitive l’année suivante.
À noter que l’abattement de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couples soumis à imposition commune) est toujours d’actualité.
Option pour le barème de l’impôt sur le revenu
Le prélèvement forfaitaire unique s’applique de plein droit. Toutefois, les contribuables ont la possibilité d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Mais attention, l’option, lorsqu’elle est exercée, vaut pour l’ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d’application du PFU. Une option qui doit être exercée chaque année au moment du dépôt de la déclaration de revenus.
En cas d’option pour le barème, le redevable peut bénéficier de l’abattement de 40 % sur les dividendes et revenus assimilés, de certains abattements pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 et déduire une fraction de la CSG acquittée.
Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31