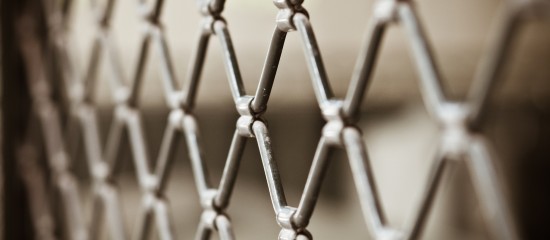La loi de 2008 simplifiant le cumul emploi-retraite prime sur les dispositions antérieures des statuts des sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales.
En décembre 2008, la loi a assoupli les conditions permettant aux professionnels libéraux de percevoir leur pension de retraite tout en poursuivant ou en reprenant une activité professionnelle. En effet, ils peuvent cumuler, sans aucune limite, leur pension avec les revenus d’une activité professionnelle dès lors qu’ils remplissent les critères pour bénéficier d’une retraite à taux plein (âge de départ en retraite, trimestres requis…) et qu’ils ont liquidé l’ensemble de leurs pensions de retraite de base et complémentaire.
Or, certaines divs professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, qui gèrent les droits à retraite des professionnels libéraux, n’ont pas immédiatement mis leurs statuts en conformité avec la loi. Autrement dit, elles ont continué à conditionner l’attribution des pensions de retraite complémentaire à la cessation d’activité des professionnels libéraux. Une pratique qui a été invalidée par la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un chirurgien-dentiste avait demandé le bénéfice de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1
En complément : la caisse de retraite faisait valoir que la loi simplifiant le cumul emploi-retraite des professionnels libéraux concernait uniquement la pension de retraite de base et ne s’appliquait pas à la pension de retraite complémentaire. Une analyse qui n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges.
Cassation civile 2e, 4 mai 2017, n° 16-16757
© Les Echos Publishing 2017