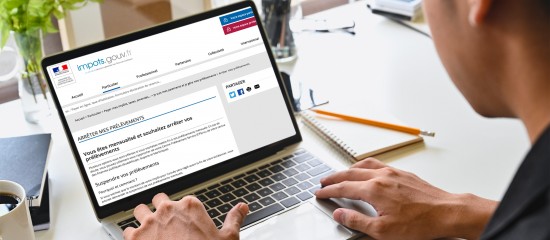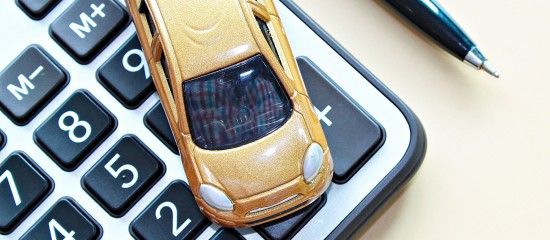Pour éviter les avances de trésorerie, les contribuables mensualisés qui bénéficieront en 2020 du dégrèvement total de la taxe d’habitation peuvent résilier ou moduler à la baisse leurs prélèvements.
Les contribuables dont le revenu fiscal de référence 2019 n’excède pas 27 706 € pour la première part de quotient familial (majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire) bénéficieront en 2020 d’un dégrèvement de 100 % de la taxe d’habitation sur leur résidence principale. Mais pour éviter une avance de trésorerie, et un remboursement de l’administration en fin d’année prochaine, les contribuables qui ont choisi d’être mensualisés peuvent, dès à présent, résilier ou moduler à la baisse leurs prélèvements. Pour ce faire, le contribuable peut se connecter à son espace particulier sur www.impots.gouv.fr à la rubrique : Paiements > Gérer mes contrats de prélèvement > Cocher le contrat de taxe d’habitation.
En pratique, deux situations peuvent se présenter :
Précision : les modifications apportées au contrat de prélèvement jusqu’au 15 décembre 2019 seront prises en compte pour le mois de janvier 2020. Et les modifications effectuées à partir du 16 décembre 2019 prendront effet à compter du deuxième mois qui les suivent.
© Les Echos Publishing 2019