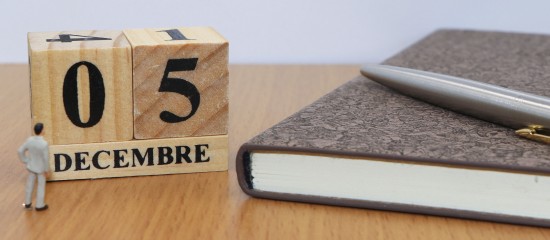Les entreprises qui reçoivent une proposition de rectification à l’issue d’un contrôle fiscal sur pièces peuvent exercer un recours hiérarchique.
Dans le cadre d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, une entreprise peut, en cas de désaccord avec le vérificateur, exercer un recours hiérarchique. Une faculté qui a été étendue, l’an dernier, aux entreprises qui reçoivent une proposition de rectification à l’issue d’un contrôle sur pièces.
À noter : un contrôle sur pièces consiste pour les agents des impôts à procéder, depuis leur bureau, à un examen critique des déclarations fiscales souscrites par l’entreprise à l’aide des éléments figurant dans leurs dossiers.
L’administration fiscale vient de préciser les modalités de mise en œuvre de ce droit.
Précision : ce recours hiérarchique ne s’applique pas dans le cadre d’une procédure de taxation ou d’évaluation d’office, ni aux impôts directs locaux.
Ainsi, l’entreprise doit être informée de la possibilité dont elle dispose d’exercer un recours hiérarchique ainsi que du nom de la personne qui en est chargée sur la proposition de rectification. La demande doit être formulée par l’entreprise et adressée à la personne nommément désignée, par écrit ou par courriel. Une demande qui peut être émise dès la réception de la proposition de rectification, peu importe le support, c’est-à-dire sur la réponse à la proposition de rectification ou par une lettre séparée. Mais attention, cette demande ne vaut pas réponse à la proposition de rectification.
Précision : la demande est destinée au supérieur hiérarchique de l’agent ayant mené le contrôle. En principe, elle est prise en charge par le chef du service auquel appartient l’agent signataire de la proposition de rectification.
Quant à la réponse de l’administration, elle intervient par écrit et ne donne pas nécessairement lieu à un entretien.
© Les Echos Publishing 2019