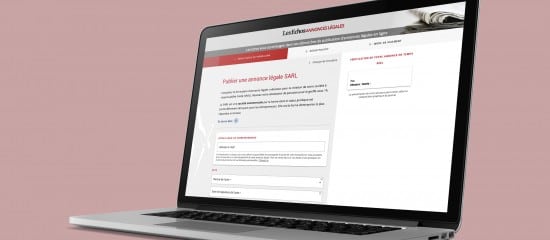La société qui s’est abstenue de désigner le conducteur ayant commis un excès de vitesse avec l’un de ses véhicules peut échapper au paiement de l’amende encourue à ce titre lorsque le procès-verbal de l’infraction de non-désignation n’est pas correctement établi.
Lorsqu’un excès de vitesse constaté par un radar automatique a été commis par un véhicule immatriculé au nom d’une société, son dirigeant doit déclarer aux autorités compétentes l’identité de la personne qui conduisait ce véhicule dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention. Et attention, s’il ne respecte pas cette obligation, il encourt (ainsi que la société) une amende pouvant atteindre 750 € (90 € si l’amende est minorée) pour non-désignation du conducteur fautif.
Mais, bon à savoir, lorsque le procès-verbal constatant l’infraction de non-désignation ne mentionne pas la date d’envoi de l’avis de contravention d’excès de vitesse, la société peut s’abstenir de payer l’amende pour non-désignation en faisant valoir que le délai de 45 jours pour dénoncer le conducteur fautif n’était pas expiré.
Défaut de mention de la date d’envoi de l’avis de contravention
C’est l’enseignement qui peut être tiré de l’affaire récente suivante. Le véhicule d’une société avait été flashé le 2 octobre 2017. La société avait reçu l’avis de contravention édité le 7 octobre suivant. Elle avait alors payé l’amende mais s’était bien gardée de dénoncer le salarié qui était au volant du véhicule. Quelque temps plus tard, elle avait reçu un deuxième avis de contravention qui avait constaté la commission de l’infraction de non-désignation du conducteur au 22 novembre 2017.
Ayant refusé de payer cette deuxième contravention, la société avait été poursuivie en justice et condamnée par les premiers juges. Mais la Cour de cassation, devant laquelle l’affaire avait été portée, a censuré cette condamnation. En effet, elle a été sensible à l’argument, développé par la société, selon lequel le PV constatant l’infraction de non-désignation mentionnait, non pas la date d’envoi de la contravention d’excès de vitesse, mais sa date d’édition. Du coup, rien ne permettait d’établir qu’au 22 novembre 2017, le délai de 45 jours pour dénoncer le conducteur était expiré… La société n’avait donc pas à payer l’amende pour non-désignation du conducteur ayant commis l’excès de vitesse.
© Les Echos Publishing 2021