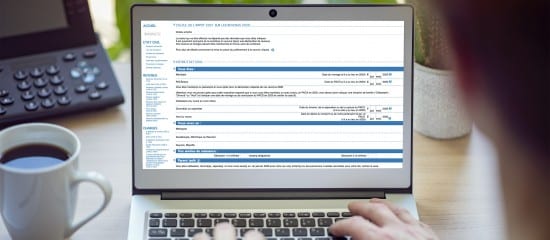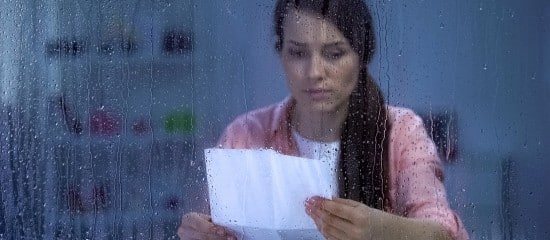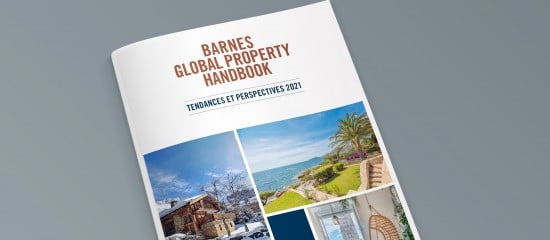Le rendement moyen des SCPI en 2020 pourrait s’établir à 4,12 %, soit une baisse de 0,28 point seulement par rapport à 2019.
D’après la dernière étude de l’Observatoire des SCPI de Linxea, malgré un contexte sanitaire et économique difficile, les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont bien résisté en 2020. Pourtant, tout portait à croire que les SCPI allaient devoir faire face, l’année dernière, à un trou d’air provoqué notamment par les confinements qui se sont accompagnés de fermetures administratives pour leurs locataires. Ce qui a pu engendrer des retards de paiement de loyers. Bien que la situation sanitaire soit loin d’être réglée, l’heure est au bilan.
Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial, une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.
Si l’on regarde les chiffres (provisoires) de la collecte, il est clair que celle-ci sera inférieure à celle de 2019 (-26 % sur les 9 premiers mois de l’année avec plus de 4,4 Md€). Toutefois, les auteurs de l’étude ont observé un rebond de la collecte avec une hausse de 16 % entre le 2
Concernant le rendement servi par les SCPI en 2020, celui-ci s’établirait (après 65 SCPI auditées) à 4,12 %. Il s’agit néanmoins d’une estimation qui sera susceptible de varier légèrement à la hausse ou à la baisse lors de l’annonce exhaustive de l’ensemble des rendements des SCPI. Sur une année marquée par la crise sanitaire, les SCPI se sont, une nouvelle fois, montrées extrêmement résidivtes en affichant un rendement en baisse de seulement 28 points de base par rapport au rendement enregistré en 2019, à 4,40 %.
Bien que les nouvelles soient bonnes, il faut garder à l’esprit que la crise sanitaire n’est pas encore terminée. Il convient de rester vigilant en 2021, sachant d’autant plus que nous ne connaissons pas encore l’ampleur réelle de la crise économique qui suivra.
© Les Echos Publishing 2021