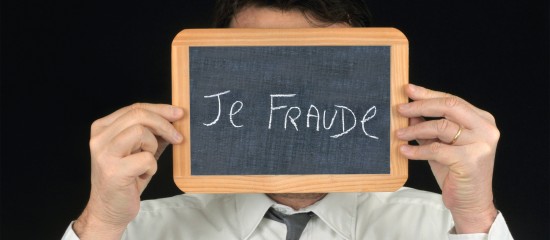Les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan annuel inférieur à 43 M€), soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, pourraient bientôt déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de certains biens affectés à leur activité industrielle.
À noter : cette déduction, pratiquée au cours des exercices clos à partir du 1er janvier 2019, serait répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.
Les biens concernés par ce suramortissement devraient relever de l’une des catégories suivantes :
– équipements robotiques et cobotiques ;
– équipements de fabrication additive ;
– logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;
– machines intégrées destinées au calcul intensif ;
– capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sur sa chaîne de production ou sur son système transitique ;
– machines de production à commande programmable ou numérique ;
– équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation.
Dates d’application
La déduction serait applicable aux biens acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2018.
Elle s’appliquerait également aux biens fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2018.
À noter : seraient aussi visés les biens neufs pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Et elle concernerait les biens acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une commande en 2019 ou en 2020 assortie du versement d’un acompte d’au moins 10 % et que l’acquisition intervienne dans un délai de 24 mois suivant la date de la commande.
Art. 18 quater, projet de loi de finances pour 2019, adopté le 23 octobre 2018 en 1re lecture par l’Assemblée nationale (1re partie)