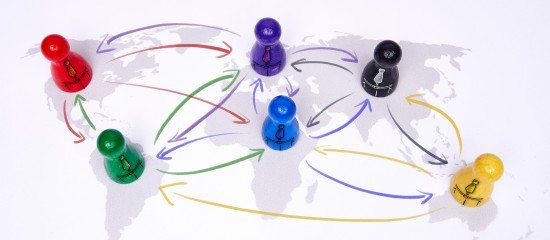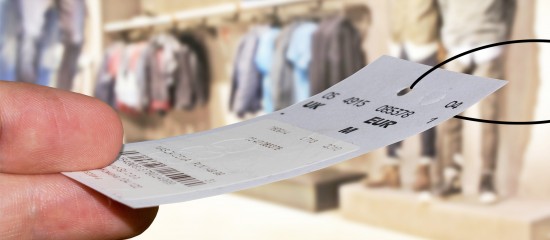La banque ne doit mettre en garde l’emprunteur que sur l’inadaptation du prêt à ses capacités financières et sur le risque d’endettement.
Des associés d’une société civile immobilière (SCI) avaient souscrit auprès d’un établissement bancaire 4 prêts destinés à financer 4 biens immobiliers. Ayant rencontré des difficultés à les rembourser, les associés s’étaient rapprochés de leur banque pour modifier les caractéristiques de leurs prêts en passant d’un taux d’intérêt variable à un taux d’intérêt fixe. Cette demande étant motivée par le fait que le projet de la SCI était, lors de la souscription du prêt, viable au taux initial de 4,8 %, mais ne l’était plus lorsque le taux avait varié à hauteur de 6 %. Se sentant lésés, ils avaient ensuite assigné la banque en paiement de dommages-intérêts au motif que cette dernière avait manqué à ses devoirs d’information et de mise en garde quant au caractère variable du taux d’intérêt stipulé dans les prêts initiaux.
Les associés n’ont pas obtenu gain de cause en justice. En effet, les juges ont estimé que l’obligation de mise en garde à laquelle est tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci à ses capacités financières et sur le risque de l’endettement qui résulte de l’octroi du prêt, et non pas sur les risques de l’opération financée. En outre, ils ont souligné que les actes notariés dressés lors de l’acquisition des biens immobiliers mentionnaient de façon parfaitement claire que le taux nominal des prêts était révisable et précisaient les conditions et les modalités de cette révision.
Cassation commerciale, 20 avril 2017, n° 15-16316
© Les Echos Publishing 2017
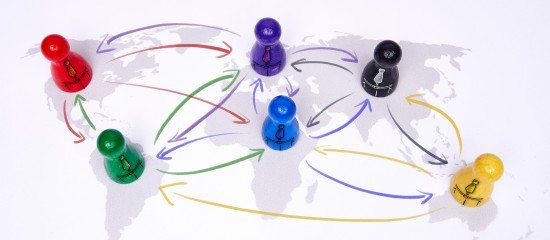
Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est égal ou supérieur à 50 M€ doivent, le cas échéant, déclarer leur politique des prix de transfert au plus tard le 3 novembre prochain.
Certaines entreprises doivent souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique des prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257, dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2016 et déposé leur déclaration de résultats le 3 mai 2017 ont jusqu’au 3 novembre prochain pour transmettre cet imprimé.
Depuis plusieurs années, sont visées par cette obligation déclarative les entreprises, établies en France, tenues d’établir une documentation des prix de transfert, à savoir celles qui :– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou qui disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 400 M€ ;– ou détiennent à la clôture de l’exercice plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;– ou sont détenues, de la même façon, par une entreprise remplissant la condition financière précitée ;– ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins un membre satisfait à l’un des 3 cas précédents.
Mais attention, cette échéance fiscale est étendue, pour la première fois, aux entreprises telles que définies ci-dessus dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 50 M€. En pratique, ces PME sont désormais concernées par l’obligation déclarative alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Elles doivent donc veiller à conserver les justificatifs relatifs aux éléments figurant dans leur déclaration afin d’être en mesure de répondre à toute demande d’informations de l’administration fiscale.
À noter : dans tous les cas, la déclaration relative à la politique des prix de transfert comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et des informations spécifiques à l’entreprise déclarante. Les entreprises qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées établies à l’étranger ou dont le montant des transactions réalisées avec de telles entités n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont toutefois dispensées de cette déclaration.
© Les Echos Publishing 2017

La réforme du Code du travail supprimerait le contrat de génération, mais les aides financières demandées avant son entrée en vigueur continueraient d’être versées.
Depuis mars 2013, le contrat de génération vise à favoriser l’embauche des jeunes en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), le maintien dans l’emploi des salariés seniors et la transmission intergénérationnelle des savoirs et des compétences. Il consiste, pour l’employeur, à embaucher un jeune de moins de 26 ans en CDI tout en recrutant ou en maintenant dans son emploi un salarié senior.
Pour les employeurs de moins de 300 salariés, la mise en place de ce « binôme » dans le cadre d’un contrat de génération ouvre droit à une aide financière de plusieurs milliers d’euros pour une durée maximale de 3 ans.
La réforme du Code du travail prévoit de mettre fin au contrat de génération. Néanmoins, les aides financières qui seront demandées avant la parution au Journal officiel de l’ordonnance « relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail » consacrant cette suppression seraient intégralement payées aux employeurs. La date exacte de parution de l’ordonnance n’est pas connue à ce jour, mais elle devrait se situer vers le 24 septembre. Les employeurs n’ont donc plus de temps à perdre s’ils souhaitent bénéficier de cette aide !
À savoir : l’employeur doit demander l’aide financière auprès de Pôle emploi dans les 3 mois qui suivent le premier jour d’exécution du CDI du jeune.
Article 10, ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
© Les Echos Publishing 2017

Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail seraient remplacés par une instance unique baptisée le « comité social et économique ».
Dans le cadre de la réforme du Code du travail, le gouvernement souhaite donner un nouveau visage à la représentation du personnel dans l’entreprise. Plus concrètement, une nouvelle instance, le comité social et économique (CSE) serait créé dans les entreprises d’au moins 11 salariés et se substituerait aux instances représentatives du personnel existantes.
Une seule instance pour représenter le personnel
Le CSE prendrait la place des délégués du personnel dans les entreprises employant au moins 11 et moins de 50 salariés. Dans celles qui occupent au moins 50 salariés, le CSE regrouperait les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Précision : la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail serait toutefois requise dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Dans les autres, la création d’une telle commission serait facultative ou pourrait être imposée par l’inspection du travail lorsque cela lui paraîtrait nécessaire.
Des compétences traditionnelles ou élargies
Le CSE disposerait des mêmes attributions que les instances qu’il serait amené à remplacer (information, consultation, recours aux expertises…). Toutefois, un accord d’entreprise ou un accord de branche pourrait étendre ses prérogatives en lui permettant de négocier, de conclure et de réviser les accords d’entreprise ou d’établissement. Fort de cette nouvelle mission, le CSE serait alors rebaptisé le « conseil d’entreprise ».
Exceptions : les accords d’entreprise soumis à des règles spécifiques de validité (contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, protocole d’accord préélectoral…) ne seraient pas concernés par cette mesure.
Des membres élus pour 4 ans
En l’absence d’accord collectif prévoyant une durée de mandat plus courte (dans la limite de 2 ans), les membres du CSE seraient élus pour 4 ans. Et si leur nombre n’est pas encore déterminé, le gouvernement prévoit, d’ores et déjà, qu’ils disposeraient d’au minimum 10 heures de délégation (au moins 16 heures pour les entreprises de 50 salariés et plus) pour remplir leurs missions. En revanche, ils ne seraient pas autorisés à effectuer plus de 3 mandats successifs, sauf dans les entreprises comptant moins de 50 salariés.
Rappel : les 5 projets d’ordonnances réformant le Code du travail, présentés fin août par le gouvernement, seront publiés au Journal officiel d’ici à la fin du mois de septembre après avis de plusieurs commissions consultatives. Nous reviendrons alors en détail sur leurs contenus.
Ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
© Les Echos Publishing 2017

Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté se porte caution sans le consentement de son conjoint, les biens communs des époux, et donc les sommes figurant sur un compte bancaire joint, ne sont pas engagées.
Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté se porte caution, par exemple pour garantir un emprunt souscrit par une entreprise, elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Les biens appartenant en commun au couple ne sont donc pas engagés par ce cautionnement, sauf si le conjoint de l’intéressé y a expressément consenti.
À noter : le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par l’autre a pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs. On comprend dès lors que ce dernier cherche, le plus souvent, à recueillir l’assentiment du conjoint de la caution lors de la signature du contrat de cautionnement. Sachant que dans ce cas, les biens propres du conjoint demeurent à l’abri des poursuites du créancier.
En l’absence de consentement exprès du conjoint, les biens communs des époux ne sont donc pas engagés par le cautionnement souscrit par l’autre. Tel est le cas des sommes déposées sur un compte bancaire joint du couple puisqu’elles sont présumées communes. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente, lesquels ont ajouté que si le créancier souhaite les faire saisir, il devra alors démontrer que ces sommes proviennent des revenus et des biens propres de l’époux qui s’est porté caution.
Cassation civile 1re, 15 juin 2017, n° 16-20739
© Les Echos Publishing 2017

Les adoptés simples mineurs n’ont plus à justifier d’une condition de secours et de soins ininterrompus pendant 5 ans pour bénéficier du régime fiscal des successions en ligne directe.
À l’occasion d’une récente mise à jour de sa base documentaire, l’administration fiscale a rappelé les conditions à respecter pour que les personnes qui ont été adoptées par adoption simple puissent bénéficier du régime fiscal des transmissions à titre gratuit (successions, donations) en ligne directe.
À noter : l’héritier ou le donataire bénéficie, dans ce cas de figure, d’un barème fiscal favorable ainsi que d’un abattement de 100 000 €.
Ainsi, pour l’enfant adopté alors qu’il était mineur au moment de la donation consentie par l’adoptant, il faut qu’il ait reçu de l’adoptant, pendant 5 ans au moins, des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale. Cette condition n’ayant plus à être remplie (depuis le 16 mars 2016) dans le cadre d’une transmission par succession lorsque l’adopté était mineur au moment du décès de l’adoptant.
En revanche, pour toutes les transmissions à titre gratuit (donations et successions), l’adopté majeur doit, soit dans sa minorité et pendant 5 ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant 10 ans au moins, avoir reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus pour pouvoir bénéficier du régime fiscal favorable.
Précision : l’adoption simple crée un a de filiation entre l’adoptant et l’adopté tout en conservant celui existant entre l’adopté et sa famille d’origine. L’adoption plénière, quant à elle, rompt tout a avec la famille d’origine.
BOI-ENR-DMTG-10-50-80 du 24 août 2017
© Les Echos Publishing 2017

À compter du 1 janvier 2019, les créateurs d’entreprise devraient, dans certaines conditions, bénéficier d’une exonération de cotisations sociales pendant leur première année d’activité.
Diminuer les charges pour soutenir l’amorçage de modèles économiques encore fragiles. Récemment annoncé par le Premier ministre, Édouard Philippe, lors de son déplacement à Dijon, un nouveau coup de pouce fiscal vise à encourager la création d’entreprise, et plus particulièrement les travailleurs indépendants s’engageant dans l’aventure entrepreneuriale.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2019, les indépendants qui créeront ou reprendront une entreprise ne payeraient plus de cotisations de Sécurité sociale (hors CSG, CRDS et cotisations de retraite complémentaire) pendant leur première année d’activité.
Précision : cette exonération totale concernerait uniquement les entrepreneurs dont le chiffre d’affaires s’élève à moins de 30 000 €. Un plafond qui, d’après Édouard Philippe, devrait couvrir « plus de 90 % des cas ». Pour les créateurs d’entreprise dont le revenu annuel net est compris entre 30 000 et 40 000 €, l’exonération s’appliquerait de manière dégressive.
Selon le gouvernement, plus de 350 000 nouveaux créateurs d’entreprise pourraient, en pratique, bénéficier de cette mesure. À titre d’exemple, pour un travailleur indépendant dégageant un revenu net de 30 000 € la première année suivant la création de son entreprise, l’exonération de cotisations sociales représenterait un gain de 9 500 €.
Enfin, les micro-entrepreneurs pourraient également bénéficier d’un allègement de charges. Selon le Premier ministre, l’entrée dans les cotisations sociales se ferait de manière progressive, s’étalant sur les 3 premières années de leur activité.
Discours du Premier ministre, Édouard Philippe, du 5 septembre 2017
Programme du Gouvernement en faveur des travailleurs indépendants
© Les Echos Publishing 2017

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un apport de trésorerie remboursable au titre des aides Pac 2017 à condition d’en faire la demande avant le 15 octobre.
Le 21 juin dernier, le ministre de l’Agriculture avait annoncé que les aides Pac 2017 seraient versées en février 2018 et qu’en attendant, un apport de trésorerie remboursable (ATR) sans intérêt serait mis en place à la mi-octobre 2017 pour pallier les difficultés de trésorerie rencontrées par les exploitants.
Cette avance de trésorerie remboursable vient d’être activée. Pour en bénéficier, les agriculteurs doivent en faire la demande avant le 15 octobre via le service en ligne Telepac. L’ATR sera ensuite versé à partir du 16 octobre.
Pour les agriculteurs ayant déposé une demande d’aide en 2016 et en 2017, le montant de l’ATR sera égal à 90 % des aides découplées de 2016, des aides couplées bovines (aides aux bovins allaitants, aides aux bovins lait) de 2016 et des indemnités compensatoires de handicap naturel (ICHN) de 2016, et à 80 % d’un montant forfaitaire par région pour les aides liées aux mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et les aides à l’agriculture biologique. Dans les autres cas, l’ATR correspondra à un montant forfaitaire.
L’ATR sera remboursé au fur et à mesure des paiements des aides et par compensation. Les éventuels reliquats devant être remboursés au plus tard le 31 mars 2018 s’agissant des aides du premier pilier de la Pac (c’est-à-dire toutes les mesures de soutien aux marchés et aux revenus des exploitants agricoles) et des ICHN, et le 31 décembre 2018 pour les MAEC et les aides à l’agriculture biologique.
À noter : l’ATR n’est pas versé si son montant est inférieur à 500 €.
Décret n° 2017-1318 du 4 septembre 2017, JO du 5
© Les Echos Publishing 2017

Afin de compenser la hausse de la CSG, le gouvernement a annoncé une baisse des cotisations sociales dues par les salariés et les travailleurs indépendants.
Au 1er janvier 2018, la CSG devrait augmenter de 1,7 point. En contrepartie de cette hausse, le gouvernement prévoit de diminuer les cotisations sociales des salariés et des travailleurs indépendants.
Ainsi, les parts de la cotisation d’assurance chômage et de la cotisation d’assurance maladie dues par les salariés, actuellement respectivement fixées à des taux de 2,40 % et de 0,75 %, seraient supprimées en 2018. Toutefois, cette mesure serait appliquée en deux temps. Une première baisse de cotisation de 2,2 points interviendrait au 1er janvier 2018, puis une seconde de 0,95 point à l’automne 2018.
Le gouvernement a précisé que cette mesure entraînerait à terme un gain de 260 € par an pour un salarié payé au Smic.
Les travailleurs indépendants, quant à eux, auraient droit, à partir de 2018, à une baisse de leurs cotisations d’allocations familiales de 2,15 points ainsi qu’à un renforcement de l’exonération dégressive de la cotisation maladie-maternité pour les non-salariés percevant un revenu annuel inférieur à 43 000 €.
Ces mesures devraient, selon le gouvernement, représenter un gain annuel de 270 € pour un travailleur indépendant gagnant un revenu égal au Smic et de 550 € par an pour un revenu mensuel de 2 400 €.
À savoir : au 1er janvier 2018, le Régime social des indépendants serait supprimé et progressivement adossé, sur une période transitoire de 2 ans, au régime général de Sécurité sociale. Les cotisations sociales des travailleurs indépendants ne seraient pas pour autant alignées sur celles des salariés.
© Les Echos Publishing 2017
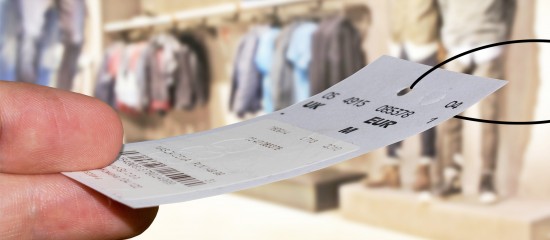
Un vendeur ou un prestataire de services pourra bientôt demander en ligne à la DGCCRF de se prononcer sur la conformité de son dispositif d’étiquetage, d’affichage ou de marquage des prix à la réglementation en vigueur.
À compter du 1er octobre 2017, un formulaire permettra aux professionnels de s’assurer auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) que les modalités d’informations des consommateurs sur les prix qu’ils pratiquent sont conformes à la réglementation. Une prise de position formelle qui peut leur permettre d’éviter une amende administrative en cas de manquement aux règles de publicité des prix (qui peut aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société).
Ce formulaire sera téléchargeable sur le site Internet de la DGCCRF, www.economie.gouv.fr/dgccrf, et sur le site www.service-public.fr. La demande devra être accompagnée de tout document, notamment de photos, permettant à la DGCCRF de prendre position sur les modalités d’information du consommateur sur les prix des biens, produits et services proposées par le professionnel.
Précision : la DGCCRF prend formellement position sur cette demande dans un délai de 2 mois à compter de la réception de celle-ci. Passé ce délai, son absence de réponse équivaut à un rejet de la demande.
Arrêté du 9 août 2017, JO du 17
© Les Echos Publishing 2017