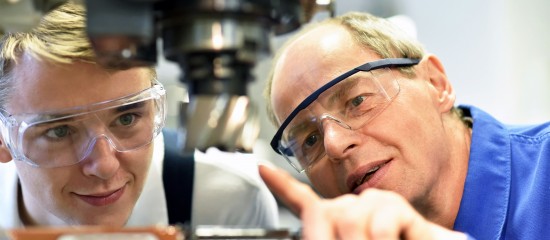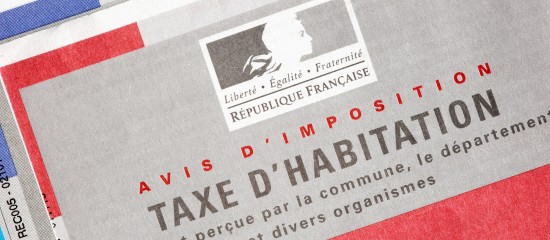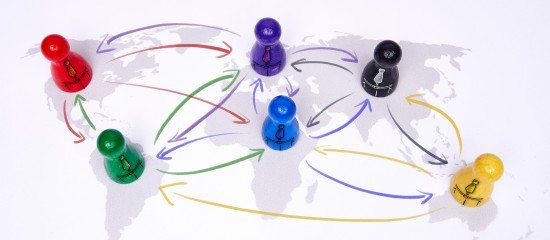Dispositif Pinel, prêt à taux zéro, plus-values immobilières… le gouvernement souhaite redéfinir la politique du logement.
Le gouvernement vient de présenter son projet de loi de finances pour 2018. Un projet contenant des mesures destinées notamment à stimuler la construction de nouveaux logements. Revue de détail.
Prorogation du dispositif Pinel
Alors qu’il devait prendre fin au 31 décembre 2017, le dispositif Pinel serait reconduit pour 4 années supplémentaires. Mais il serait réservé aux communes dans lesquelles le manque de logement est le plus important, c’est-à-dire dans les zones A, A bis et B1. Exit donc celles faisant partie des zones B2 et C. Hormis ce nouveau zonage, le dispositif ne connaîtrait pas de changements notables.
Rappelons que le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans). Cette réduction, répartie par parts égales sur cette durée d’engagement de location, est calculée sur le prix de revient du logement, retenu dans la double limite de 5 500 € par m² de surface habitable et de 300 000 €.
Recentrage du prêt à taux zéro
Les primo-accédants n’ont pas été oubliés. Le prêt à taux zéro (PTZ) ferait également l’objet d’une reconduction jusqu’au 31 décembre 2021. Là encore, le dispositif serait revu : le PTZ, pour l’achat d’un logement neuf, ciblerait uniquement les zones A, A bis et B1 (et la zone B2 mais uniquement durant l’année 2018). Pour les logements anciens, le PTZ ne devrait plus être proposé que pour les zones où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est moins marqué (B2 et C).
Incitation à la libération du foncier
Dans l’optique de favoriser la construction de logements dans les zones tendues, le gouvernement souhaiterait mettre en place de nouveaux abattements applicables aux plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un terrain à bâtir. L’abattement serait de 100 % lorsque le terrain sera destiné à accueillir des logements sociaux, de 85 % pour des logements intermédiaires et de 70 % pour des logements en secteur libre.
Précision : ces abattements ne seraient applicables que pour les promesses de ventes conclues avant le 31 décembre 2020.
Soutien à la transition énergétique
Afin de poursuivre les actions en matière écologique, le gouvernement souhaiterait reconduire le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) jusqu’au 31 décembre 2018. Au-delà, il serait transformé en prime, dont le versement serait contemporain de la réalisation des travaux. Toutefois, la liste des dépenses éligibles au dispositif serait recentrée sur celles permettant de réaliser le plus efficacement des économies d’énergies. Par exemple, l’installation de portes et fenêtres serait progressivement exclue de l’assiette du crédit d’impôt, même si elle demeurera éligible au taux réduit de TVA.
© Les Echos Publishing 2017