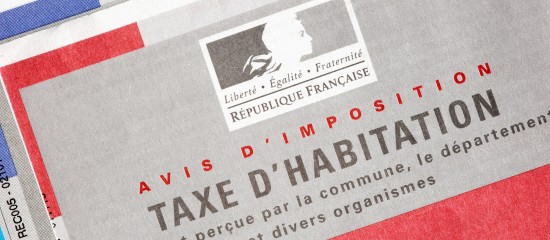Leur succès ne se dément pas. Ils pèsent aujourd’hui près de 4 000 milliards de dollars dans le monde. Et rien que depuis le début de l’année, les souscriptions d’exchange traded funds (ETF) ont atteint 253,31 milliards de dollars. Un engouement qui n’est visiblement pas près de s’arrêter.
Une bonne raison de s’intéresser à ce qui peut pousser les investisseurs à s’orienter vers ces produits atypiques.
Portrait-robot des ETF
Placés sous l’étiquette des produits à gestion passive, les ETF sont des supports d’investissement cotés en Bourse dont l’objet est de répliquer les variations, à la hausse ou à la baisse, d’un « sous-jacent » (indice boursier, panier d’actions ou d’obligations, pays, secteur d’activité, type d’entreprise…) pris en référence. Concrètement, le gérant constitue les ETF comme un fonds d’investissement traditionnel (OPCVM), c’est-à-dire en détenant en portefeuille les titres composant le sous-jacent.
Notons également que certaines sociétés d’investissement proposent des ETF à effet de levier. Ces derniers peuvent multiplier la performance d’un sous-jacent ou générer du rendement à l’inverse de l’évolution de l’indice (ETF baissiers). Des supports d’investissement pouvant être plus performants mais aussi beaucoup plus risqués que les ETF « classiques ». À utiliser donc avec prudence !
L’intérêt des ETF
Le principal intérêt des ETF consiste en la certitude de bénéficier des mêmes performances que celles du sous-jacent dupliqué, de l’indice CAC 40 par exemple. Le gérant de l’ETF ne cherchant pas à surperformer l’indice. Attention donc, si les cours du sous-jacent s’effondrent, les ETF subiront dans les mêmes proportions une baisse de leurs performances.
En termes de fonctionnement, les ETF se négocient comme les actions et permettent d’investir, en une seule opération, dans un indice ou un panier de titres.
Outre leur grande diversité, les exchange traded funds présentent un autre attrait : leur tarification. En effet, leur coût réduit les rend particulièrement attractifs puisqu’ils ne supportent ni frais d’entrée ni frais de sortie. Seuls des frais de gestion allant de 0,05 % à 0,7 % sont prélevés. Revers de la médaille, le faible niveau de ces frais n’encourage pas tous les courtiers à proposer des ETF sur leurs plates-formes.
Enfin, il faut souligner que les ETF peuvent être souscrits par le plus grand nombre puisqu’ils sont, pour la plupart, éligibles au plan d’épargne en actions, au compte-titres ordinaire et à l’assurance-vie via des unités de compte.
Des actifs liquides
Les exchange traded funds sont des actifs bénéficiant d’une certaine liquidité. Cela signifie que ces supports d’investissement se négocient facilement sur les marchés financiers. Sachant que cette liquidité est soutenue par des teneurs de marché (market makers). En pratique, ces derniers s’engagent à se porter contrepartie à l’achat et à la vente sur les différentes places de cotation.